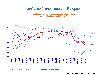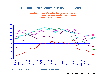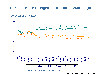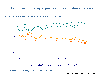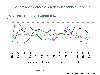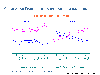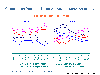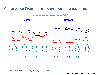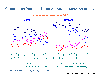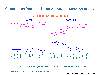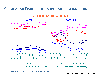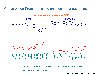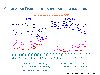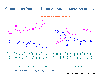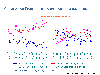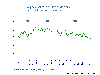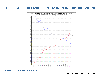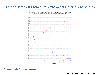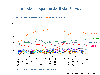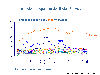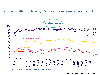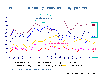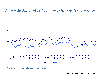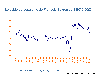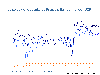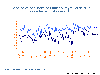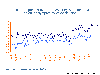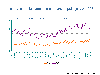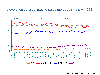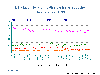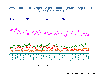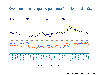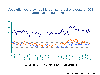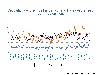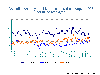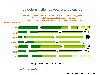Dixième édition des Forums de Canal Ipsos
- 1996-2003 : deuxièmes années de mandat difficiles pour Jacques Chirac et son Premier Ministre
- Réforme et popularité sont-elles compatibles ?
- Nicolas Sarkozy : un phénomène d'opinion
- François Bayrou et "la Nouvelle UDF"
- A 3 mois des régionales, revue de troupes
En un an, le "moral économique" des Européens s’est fortement détérioré. En France particulièrement, le solde de confiance quant à la situation économique du pays (différence entre part d’optimistes et de pessimistes) est tombé à -32 en novembre. Le gouvernement n’est pas parvenu à maintenir une confiance économique majoritaire sous l’ère Jospin. Au contraire, la dégradation est continue depuis mai 2002 (-50 points en terme de solde).
A titre plus personnel, les Français n’anticipent pas non plus d’amélioration de leur pouvoir d’achat. Là encore, le solde d’opinion s’est dégradé de plus de 30 points depuis mai 2002, pour devenir largement négatif, à -21 en novembre. Désormais le pessimisme l’emporte largement, à tel point que les Français sont aujourd’hui les plus inquiets de tous les Européens (*) en ce qui concerne "l’évolution de leur niveau de vie et le pouvoir d’achat de leur foyer dans les prochains mois".
L’évolution dans l’opinion de l’arbitrage consommation / épargne, de plus en plus favorable à l’épargne, confirme cette inquiétude. Le réflexe "épargne de précaution" progresse, tout particulièrement chez les Français aux "revenus modestes". Pierre Giacometti fait remarquer que c’est précisément cette catégorie de population, environ 40% des Français, qui de part sa masse impulse la tendance, et les difficultés du gouvernement.
Est-ce le climat économique particulièrement mauvais qui altère la confiance politique, où la défiance dans l’action gouvernementale qui incite au pessimisme quant à l’évolution de la situation économique ? Interrogé par Eric Dupin sur le sens de la causalité, François Bayrou semble plutôt pencher pour une responsabilité gouvernementale. S’inquiétant du moral des Français, "le plus bas de toute l’Europe", il ne croit pas au phénomène purement conjoncturel : le problème essentiel est selon lui le manque de lisibilité de l’action politique, problème démocratique qui serait à la source des alternances politiques qui se succèdent depuis 25 ans. "Le gouvernement actuel est particulièrement frappé par cette absence de lisibilité. Le Président de la République devrait donner le cap, ce n’est pas le cas. Le brouillage de la politique a atteint un niveau sans précédent".
S’interrogeant sur la ligne du gouvernement, il regrette que l’espoir du printemps 2002, fort pendant un an, soit aujourd’hui déçu. Ce phénomène serait d’autant plus regrettable qu’il ne croit pas à la thèse selon laquelle les gouvernements, contraints par la conjoncture économique, n’aient pas de marge de manœuvre. Selon lui, la confiance des Français ne reviendra que si le Président de la République mesure le lien qui l’uni aux citoyens qui l’ont élu. Il relève encore que Georges W. Bush et Tony Blair parlent presque tous les jours à leurs concitoyens. François Bayrou insiste tout de même sur la pertinence du levier européen comme outil de politique économique, et rappelle son attachement à la construction d’une Europe politique.
 Aujourd’hui, dans aucun des grands pays d’Europe, le chef du gouvernement ne suscite la confiance de plus d’un citoyen sur trois. Ce constat nous amène à relativiser quelque peu les mauvais chiffres de popularité enregistrés pour l’exécutif français. La spécificité du fonctionnement de la cinquième République, qui confère au chef de l’Etat le pouvoir de désigner – et de remplacer – son Premier ministre, donne pourtant en France une résonance à cette impopularité qui n’existe pas ailleurs.
Aujourd’hui, dans aucun des grands pays d’Europe, le chef du gouvernement ne suscite la confiance de plus d’un citoyen sur trois. Ce constat nous amène à relativiser quelque peu les mauvais chiffres de popularité enregistrés pour l’exécutif français. La spécificité du fonctionnement de la cinquième République, qui confère au chef de l’Etat le pouvoir de désigner – et de remplacer – son Premier ministre, donne pourtant en France une résonance à cette impopularité qui n’existe pas ailleurs.
La comparaison des secondes années de mandat de Jacques Chirac, 1996 et 2003, incite encore à relativiser l’impopularité du Premier ministre. Si Alain Juppé est installé très tôt dans l’impopularité, Jean-Pierre Raffarin suscite toujours en début d’année un espoir considérable ; ce n’est qu’en juin qu’il bascule dans l’impopularité. Plus qu’Alain Juppé, dont la popularité était fortement corrélée à celle du chef de l’Etat, Jean-Pierre Raffarin joue aujourd’hui un rôle de fusible. La relative résistance de la côte de Jacques Chirac à la dégradation de la perception de l’action gouvernementale s’explique évidemment par les positions du chef de l'Etat sur la scène internationale, dans les débats sur l’opportunité d’une intervention militaire en Irak : le Président culmine à 70% d’opinions favorables en avril. Mais la stabilité des jugements depuis octobre, alors que ceux concernant Raffarin continuent de se dégrader, plaide en faveur d’une relative "protection" du chef de l’Etat par le chef du gouvernement.
 Le détail des opinions par famille politique présente encore une situation moins tendue en 2003 qu’en 1996. A cette époque déjà, l’UDF était critique vis-à-vis du Premier ministre. Aujourd’hui, une large majorité des sympathisants centristes approuve toujours Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, même si pour ce dernier les choses se dégradent.
Le détail des opinions par famille politique présente encore une situation moins tendue en 2003 qu’en 1996. A cette époque déjà, l’UDF était critique vis-à-vis du Premier ministre. Aujourd’hui, une large majorité des sympathisants centristes approuve toujours Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, même si pour ce dernier les choses se dégradent.
Le fait qu’un Premier ministre de droite soit impopulaire à gauche est un constat classique. On relèvera en revanche qu’à gauche aussi, le chef de l’Etat semble relativement protégé, comparativement à l’impopularité qui était la sienne en 1996. Cette situation reste toutefois fragile : chez les sympathisants de gauche plus encore que sur l’ensemble de la population, l’impact de la politique internationale soutient la popularité du Président. En 2004, année électorale, les enjeux de politique intérieure vont redevenir plus importants.
Le focus sur l’électorat RPR/UMP confirme un désaveu moins fort pour Jean-Pierre Raffarin que pour d’Alain Juppé, dans leur propre camp. Même si les critiques progressent, un peu plus de 10% des proches de l’UMP portaient en novembre un jugement défavorable sur Jean-Pierre Raffarin ; la contestation envers Alain Juppé chez les sympathisants RPR en 1996 était trois fois plus forte.
L’étude de l’opinion chez les proches du FN conduit à des conclusions similaires. Mais que l’on s’attarde sur la proximité partisane ou que l’on considère l’ensemble des Français, Pierre Giacometti rappelle que l'on n’est pas encore au point de tension maximale. Le baromètre est orienté à la baisse, et la campagne électorale à venir ne garantit pas un retournement de situation, même chez les proches de la majorité.
La perspectives des régionales 2004 ne doit toutefois pas inciter aux conclusions hâtives : si une bonne popularité n’a jamais garantit un résultat électoral, l’impopularité du gouvernement n’annonce pas non plus la défaite de la droite en 2004. Quel que soit le scrutin, les tendances de popularité sont souvent décalées des résultats électoraux. La bienveillance envers Lionel Jospin n’a pas empêché des résultats décevants pour la gauche en 1998 ou 2001. En revanche, l’impopularité de Pierre Mauroy et surtout d’Edith Cresson s’est confirmée dans les urnes.
Est-il possible de gouverner – et de réformer – sans être impopulaire ? La question d’Eric Dupin incite François Bayrou à préciser dans un premier temps le statut qu’il accorde aux mesures de popularité, et aux enquêtes d’opinion. Pour lui, "les sondages ne mesurent ce que les citoyens verbalisent". Même si la constitution par le sondeur d'un questionnaire pertinent doit permettre de contourner cette difficulté, il doute que ce soit à propos de la politique que les interviewés expriment le mieux leur jugement. Les 2 à 3 % d’intentions de vote dont il était crédité durant la pré-campagne présidentielle l’auraient aussi conduit à garder une certaine distance vis-à-vis des enquêtes d’opinion …
Indépendamment des réserves inhérentes à l’outil de mesure, François Bayrou estime que l’on peut susciter la confiance sans être populaire. Citant en exemple Raymond Barre, il juge que l’on peut réformer à condition qu’une "expression de vérité indiscutable, à contrario des coups médiatiques, ou des campagnes de communication", suscite la confiance des Français. José Maria Aznar, qui aurait gommé de son discours les bonnes formules et la rhétorique, pour une parole presque "privée ou terne", en est un bon exemple. "Pour que l’on puisse réformer, il faut que le citoyen-spectateur accorde à l’homme politique le crédit que l’on accorde à l’honnête homme." La rareté de la parole présidentielle ne permettrait pas une telle confiance de l’opinion. Le contre-exemple : Nicolas Sarkozy.
 Lorsque l’on demande aux Français leur avis sur telle ou telle personnalité, huit personnes sur dix choisissent les items les plus mesurés, émettant des avis "plutôt" favorables ou défavorables. Le poids des "très favorables" concernant l’action de Nicolas Sarkozy est un cas unique (25% aujourd’hui, contre une norme à 5%). Bernard Kouchner et Jack Lang, qui accompagnent Nicolas Sarkozy sur le podium des leaders politiques préférés des Français, sont loin de bénéficier d’un socle aussi solide.
Lorsque l’on demande aux Français leur avis sur telle ou telle personnalité, huit personnes sur dix choisissent les items les plus mesurés, émettant des avis "plutôt" favorables ou défavorables. Le poids des "très favorables" concernant l’action de Nicolas Sarkozy est un cas unique (25% aujourd’hui, contre une norme à 5%). Bernard Kouchner et Jack Lang, qui accompagnent Nicolas Sarkozy sur le podium des leaders politiques préférés des Français, sont loin de bénéficier d’un socle aussi solide.
La comparaison des avis très favorables au Président et au Premier ministre montre que l’état de grâce dont bénéficiaient les deux têtes de l’exécutif au lendemain de la séquence électorale 2002 a en revanche disparu. Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin sont sur cet indicateur "rentrés dans la moyenne" des personnalités testées au baromètre de l’action politique Ipsos-Le Point.
Si pour les trois hommes les mesures de l’adhésion globale restent assez proches, il existe une vraie "exception Sarkozy" sur l’adhésion forte, et ce quelle que soit la proximité partisane des répondants.
Pour François Bayrou, le soutien envers Nicolas Sarkozy est simplement la récompense de son travail, dont il salue la qualité et le constance. Il met quand même en garde contre les dangers d’une "guerre de succession" au sein de l’UMP, qui pourrait porter préjudice au Ministre de l’Intérieur.
 L’évolution de la popularité de François Bayrou est révélatrice de la perception des Français vis-à-vis de l’UDF. Controversé pendant une longue période, et surtout au moment de la création de l’UMP, la campagne présidentielle et sa position critique face à la majorité lui permettent de retrouver aujourd’hui un solde d’opinion assez largement favorable, en partie grâce à une meilleure lisibilité de son action politique (moins de "sans opinion").
L’évolution de la popularité de François Bayrou est révélatrice de la perception des Français vis-à-vis de l’UDF. Controversé pendant une longue période, et surtout au moment de la création de l’UMP, la campagne présidentielle et sa position critique face à la majorité lui permettent de retrouver aujourd’hui un solde d’opinion assez largement favorable, en partie grâce à une meilleure lisibilité de son action politique (moins de "sans opinion").
L’identification dans l’opinion de UDF à François Bayrou s’est également consolidée. On relèvera encore que le discours de Bayrou est approuvé par la majorité des sympathisants de gauche.
Il n’y a guère que chez les sympathisants UMP que subsiste un décalage entre la popularité de l’UDF et celle de son chef de file. Aujourd’hui, seulement la moitié des électeurs UMP approuvent l’action de François Bayrou : "déjà pas si mal", selon lui.
Eric Dupin s’explique le succès de François Bayrou en proposant une nouvelle disposition de l’échiquier politique, sur lequel l’UDF ne serait plus au centre, mais à l’un des pôles d’un triangle contestataire Besancenot / Le Pen / Bayrou. Pour lui, extrême droite, extrême gauche et "extrême centre" incarnent à leur manière le mécontentement face au "nouveau centre", ventre mou et pluriel, que composerait l’UMP et le PS. Outre leurs similitudes sociologiques, les deux partis véhiculent chacun les déceptions et échecs d’une action gouvernementale controversée.
François Bayrou propose une interprétation "différente, sans être antagoniste" : habitués aux arcanes du pouvoir, le PS et l'UMP seraient issus du même moule. S’opposant systématiquement l’un à l’autre, ils leur suffit d’attendre l’alternance pour conserver le monopole du pouvoir à deux. Rappelant l’échec du récent référendum sur l’Assemblée unique aux Antilles, pourtant soutenu par "une coalition UMP-PS pour se partager tous les pouvoirs", il estime que les gens commencent à se rendre compte de ce pacte à deux. Il croit déceler dans la victoire du "non" au référendum une autonomisation du corps électoral : les Français attendent aujourd’hui une autre proposition politique, construite sur le refus de la manière dont on les gouverne, tout en étant constructive. Cette dernière dimension différencierait l’UDF de l’extrême gauche ou du FN, formations purement contestataires. Au contraire, son projet est plus ambitieux. Constatant que "le parti de la Réforme et de la Justice est majoritaire en France, depuis très longtemps", ("la condition même de la réforme est d’être insoupçonnable du point de vue de la justice"), il pense profiter de l’usure du PS pour rassembler sur cette base une large majorité de Français, composite des déçus du PS et des sympathisants de droite. D’où l’idée d’un grand parti majoritaire, ancré sur une sensibilité européenne, une volonté de réforme cadrée par un projet social : "la violence de la société prouve que la démocratie n’y joue pas son rôle : le Président ne s’adresse jamais aux Français, le gouvernement est fermé, le parlement n’est qu’une chambre d’enregistrement. Les institutions sont vidées de leur sens, et ça n’étonne plus personne, une situation qui rappelle la fin de la 4ème République. Une rénovation profonde de la démocratie est nécessaire".
Rappelant le peu de pertinence des mesures d’intentions de vote actuelles, l’échéance électorale étant encore trop lointaine, Pierre Giacometti préfère s'attarder sur l’évolution de la sympathie partisane.
Depuis 1998, le nombre de Français se déclarant proche de l’extrême gauche a doublé (5%). Si l’on reste toujours assez loin d’un socle électoral FN qui s’est consolidé depuis la présidentielle, les conditions sont toutefois propices au bon comportement de ces deux forces.
La part des électeurs proches de l’UMP et de l’UDF est restée stable depuis 1998, aux alentours de 35%. Avec une Gauche "plurielle" globalement moins soutenue qu’en 1998, le rapport de force global – toujours sur la base de la sympathie partisane déclarée- reste aujourd’hui favorable à la droite.
A gauche, l’érosion des sympathisants PS est nette depuis 1998. L’extrême gauche a rattrapé et dépassé le Parti communiste, dont moins de 5% des Français se déclarent proches. En revanche la sensibilité écologiste, toujours forte, reste une composante majeure de la gauche plurielle. Si l’on ne retient que l’avis des ouvriers, ces évolutions sont encore plus nettes. Pour Eric Dupin, l’extrême gauche a remplacé le PC, symboliquement et électoralement.
A droite, et toujours sur la base de la sympathie partisane, le niveau de soutien pour l’UMP est aujourd’hui le même que celui du RPR en 1998. Avec l’UDF, en progression depuis la création de l’UMP pour se situer au niveau de 98, et un FN consolidé, on retrouve à la veille des régionales le découpage traditionnel de la droite. La tendance est semblable chez les jeunes, moins nette chez les ouvriers et les employés, où la baisse d’influence de l’UMP, souvent au profit du FN, montre que la dimension "populaire" de l’UMP est touchée. La progression de la sympathie envers le FN dans ces catégories laisse supposer que le FN restera fort dans les régions où il l’est déjà.
Le FN reste en effet, plus que les autres formations, très à l’abri des concurrences. Alors que pour toutes les autres formations, le socle d’électeurs est soumis à pression, le FN dispose d’une base de 2/3 de sympathisants totalement acquis à sa cause.
Eric Dupin conclue à l’échec de l’UMP, sur le U de union comme le P de populaire. François Bayrou y voit encore la preuve "du besoin, impossible à contredire, de pluralisme en France". L’idée d’un parti unique, voire d’une pensée unique, est pour lui sans avenir. Il refuse en revanche que la Nouvelle UDF occupe la place laissée par l’ancienne. "Loin des querelles de paroisses", il ambitionne "un mouvement politique porteur d’un projet pour la France, la société française, l’Europe, et l’Avenir des citoyens".
(*) Indice Européen de la Consommation Ipsos-Sofinco, réalisé en Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, France et Italie.