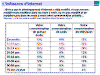Journalisme : les grands reporters ont la cote
Les Français font de " l'indépendance, l'intégrité " la première qualité d'un bon journaliste (34%), loin devant " la qualité d'analyse et de synthèse " (13%) ou encore " le sens de l'écoute " (10%). Les autres qualités testées - comme la curiosité, la culture générale, le courage, la qualité rédactionnelle, la rapidité et la ténacité - n'obtiennent que des scores modestes, situés entre 8 et 2%.On note un certain nombre de différences de perception liées au statut social de la personne interrogée. Ainsi les 15-19 ans insistent-ils plus particulièrement sur la curiosité (21%, contre 8% pour l'ensemble), ou encore le sens de l'écoute (15%, contre 10% pour l'ensemble). Les plus de 35 ans (37%) - et notamment les 45-59 ans, avec 44% - mettent quant à eux particulièrement en avant l'indépendance, l'intégrité.
La totalité des métiers du journalisme qui ont été testés dans le cadre de cette enquête est jugée de manière favorable par les Français, avec toutefois des niveaux sensiblement différents selon les cas.On constate en premier lieu que le "mythe" du grand reporter perdure au sein de l'opinion publique. Une très grande majorité des personnes interrogées (87%) dit avoir une bonne image de cette profession, ce qui la place en tête de la hiérarchie. L'ensemble des catégories socio-démographiques partage ce constat très largement positif.Le présentateur de journal radio obtient un score légèrement inférieur, avec 82% d'opinions positives. Les personnes utilisant comme source d'information principale la radio affichent une reconnaissance supérieure à l'ensemble (87%).Au troisième rang, mais sensiblement derrière, se situent ex æquo le présentateur de journal télévisé (77%) et le journaliste scientifique (77%). Au regard des catégories sociales, il est à noter que l'image positive du présentateur télévisé est particulièrement positive chez les femmes (83%), les 15 à 19 ans (83%), les employés (88%), les ouvriers (83%), les personnes disposant d'un bas salaire (85%) ou ayant un niveau d'études primaires (86%) ou secondaires (82%).
Les personnes ayant principalement recours à la télévision pour s'informer affichent également un taux supérieur (82%). Le journaliste scientifique est en revanche particulièrement valorisé par les hommes (81%), les professions intermédiaires (89%), les cadres supérieurs (86%), les employés (82%) et par les personnes ayant effectué des études supérieures (85%) ou bien une formation technique (81%). Les lecteurs de la presse magazine sont aussi plus nombreux à apprécier ce métier (82%).
En revanche, les éditorialistes et les critiques d'arts, de lettres, de spectacles se situent en fin de hiérarchie, même si une majorité de Français ont une bonne image de ces activités (52%). Tandis que les premiers sont plus appréciés par les personnes qui lisent la presse plutôt que celles qui regardent la télévision, les derniers peuvent se réjouir d'une image particulièrement bonne auprès des femmes (57%) et des moins de 35 ans (57%), en particulier les jeunes âgés de 15 à 19 ans (61%), très grands consommateurs des films cinématographiques par exemple.
Les différences de perception les plus remarquables à l'analyse sont en fait imputables au niveau d'études des personnes interrogées. Pour exemple, les personnes ayant un niveau d'études primaires ou secondaires marquent un net attachement au présentateur du journal télévisé, sensiblement moins apprécié par les niveaux d'études supérieures.
L'évolution de l'image de ces différents métiers confirme la hiérarchie actuelle. L'ensemble des métiers testés a une image en progrès par rapport à ce que pensaient d'eux les interviewés il y a dix ans. Mais les métiers dont l'image est en retrait sont également ceux pour lesquels le gain d'image a été le moins important.
On note toutefois que le clivage hommes/femmes se réactive. Les hommes sont toujours plus nombreux à estimer que l'image de ces métiers s'est détériorée ou n'a pas évolué. On constate un clivage semblable entre les personnes utilisant d'Internet comme principale source d'information et celles qui se réfèrent aux médias traditionnels (presse, radio, TV). Les internautes paraissent plus sévères dans leur jugement relatif à l'évolution du journalisme.
Le développement d'Internet n'a, si l'on en croit les Français, qu'une influence marginale sur la consommation médiatique actuelle. 5% des personnes interrogées déclarent avoir déjà modifié leur consommation actuelle de la télévision, 4% leur consommation de presse et 3% leur consommation de radio.Les internautes constituent évidemment la catégorie la plus en avance sur ce sujet. Leur profil sociologique est toutefois assez restreint : les hommes, les moins de 35 ans, les cadres, les personnes résidant dans l'agglomération parisienne ou ayant effectué des études supérieures constituent aujourd'hui la grande masse des internautes français, et sont également les catégories sociales les plus enclines à déclarer que l'arrivée d'Internet a déjà modifié leurs consommations médiatiques.
Le potentiel d'une éventuelle modification dans les mois à venir est en revanche plus important. Environ un Français sur dix pense changer son mode de consommation dans les mois à venir. C'est notamment le cas des plus jeunes. Une très grande majorité prévoit toutefois de ne pas modifier ses habitudes actuelles dans un avenir proche, s'agissant notamment de la radio (81%), la presse écrite et la télévision atteignant des taux un peu inférieurs (77% et 76%).