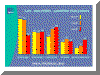Les tendances d''opinion et de consommation en 2000
En prenant un peu de recul, il devient en effet possible d'extraire la multitude d'informations 'dormantes' que recèle ce palmarès. Il prend alors du sens, et en éclairant le présent, il esquisse l'avenir.
En effet, ce qui plaît et ce qui ne plaît pas, ce qui marche et ce qui ne marche pas, est significatif de l'évolution des valeurs, des besoins, des attentes et des comportements des français. Si ce qui plaît dans une marque, un produit ou une publicité, nous renseigne sur l'état de la société, cela nous renseigne aussi sur son évolution possible.
L'inverse est également vrai. L'évolution des valeurs, l'appétit de consommation, le degré de confiance en l'avenir des français est déterminant dans la stratégie d'une marque. Comprendre le réel et le présent reste donc une étape indispensable avant de se projeter dans l'avenir. Clarifions immédiatement un point : les Français changent-ils radicalement dès lors qu'ils sont consommateurs ou citoyens ? Nous ne le pensons pas.
C'est une erreur de découper l'individu selon plusieurs fonctions, préjugeant que ses comportements sont autonomes les uns des autres, selon qu'il ait à choisir un produit, à élire un responsable, à rejeter une idée, à épouser une cause, à aimer une œuvre d'art ou à apprécier tout simplement une publicité. Nos comportements ne sont pas guidés par des stimuli issus de zones indépendantes, comme autant de compartiments étanches de notre cerveau. Le 'citoyen-consommateur' est 'un et indivisible'. Mû sans doute par des motivations complexes, il n'en demeure pas moins cohérent.
Nous avons donc jugé utile de vous résumer les grandes tendances d'opinion et de consommation des français. Plus précisément de quelle manière, l'évolution des attitudes françaises impacte sur la stratégie des marques.
I. L'OPTIMISME : CA VA MIEUX, SURTOUT MOI
La principale tendance est en réalité un fait. Il caractérise en soi la période que nous vivons, c'est le retour durable de l'optimisme. Nous avons quitté une période durant laquelle les Français pensaient que demain serait moins bien qu'hier pour entrer de plein pied dans une période ou l'avenir se lit avec espoir et confiance.
Mais ce constat mérite d'être nuancé. Cet optimisme est fragile car il repose essentiellement sur la confiance individuelle des français dans leur propre avenir. Cet optimisme est loin d'être identique, dés lors qu'il concerne l'avenir de la société. Quand il s'agit de se projeter collectivement dans l'avenir, les Français sont plus inquiets, plus méfiants. Davantage maîtres de leurs destins individuels les Français craignent que la maîtrise du destin de la collectivité leur échappe encore.
Tous les repères en sont bouleversés car les attentes ont changé. En effet cette confiance nouvelle en l'avenir fait surgir de nouvelles aspirations et de nouveaux besoins, elle modifie le rapport de français aux autres et à eux mêmes.
II. L'INDIVIDU : MOI, COMME JE SUIS, DIFFERENT
Quel crédit donner aujourd'hui à la nomenclature de l'INSEE. Que signifie aujourd'hui 'une profession intermédiaire'. Sans doute plus grand chose. Notre société s'est atomisée. De nouveaux groupes, de nouvelles identités, de nouvelles appartenances façonnent l'organisation sociale de notre pays. Il devient de plus en plus complexe, voire vain, de la décrypter selon une grille de lecture vieille de cinquante ans.
L'évolution des lignes de clivages qui traversent la société française est révélatrice de l'individualisation des comportements. En effet, le niveau d'instruction est aujourd'hui avec le revenu, un meilleur indicateur des clivages sociaux que la catégorie socioprofessionnelle. La situation matrimoniale ou le lieu de résidence, qui correspondent donc à des choix de vie individuels sont également des facteurs de différenciation significatifs. Les lignes de clivages sont aujourd'hui plus individualisées. En effet elles dépendent davantage de destins individuels que des appartenances collectives.
Cette individualisation ne signifie pas pour autant le repli sur soi, l'enfermement égoïste. Si le conformisme, l'institutionnel sont en déclin dans notre société, cela ne signifie pas pour autant que les gens aient abandonné leurs valeurs. Simplement, ils ne se réfèrent plus (ou moins en tous cas) à des systèmes idéologiques tout faits mais personnalisent des principes en les adaptant à leur univers de proximité.
La famille en est une excellente illustration. Quand on interroge les Français sur ce qui compte le plus pour eux, elle arrive toujours en tête, devant le travail, la sociabilité de proximité (amis, relations) et les loisirs, très loin devant la politique et la religion. Mais toutes les enquêtes qualitatives montrent que les valeurs familiales ont profondément évolué. Ce que les gens valorisent, ce n'est plus la famille comme institution autour du mariage, mais une famille d'abord fondée sur les relations interpersonnelles et les sentiments (particulièrement avec les enfants) et qui par conséquent peut fluctuer (s'élargir notamment) au fil du temps.
L'essor des communautés et des réflexes communautaristes est une autre illustration de ce phénomène. La communauté qu'elle se détermine en fonction d'un territoire (la cité), d'un style de vie ('surfers, snowboarders'), d'une culture et d'une région (regain des mouvements autonomistes et culturels bretons, corses, basques…), de la sexualité (gays), vient répondre à une demande plus forte de reconnaissance individuelle.
L'individualisation des comportements est aussi perceptible dans l'évolution du rapport des français à l'argent. La déculpabilisation est nette. La tendance à l'affirmation de soi et l'émancipation individuelle s'incarne dans une relation de plus en plus décomplexée aux plaisirs de l'argent facile ou au pouvoir qu'attribue l'argent. La relation à l'argent devient plus franche. Les enquêtes récentes sur les trends de consommation et les valeurs témoignent de cette lente mutation dans la relation à l'argent. Les tabous se lèvent. La relation directe au prix se fait plus aisée, la volonté de ' négocier ' progresse. Le jeu sur le prix devient un élément de valorisation du produit, les jeux de hasard explosent … Le succès fulgurant du jeu ' qui veut gagner des millions ' confirme ce rapport délivré et assumé à l'argent.
D'une manière générale, la perspective d'une société plus porteuse de progression sociale modifie le rapport à la richesse et à la réussite. 'Tout est possible'. Jamais la soif de réussite sociale et financière n'a atteint de tels niveaux de discours chez les jeunes notamment, qui décrivent comme l'ensemble des Français un pays qui va mieux et saluent les entreprises et leurs protagonistes qui 'gagnent'.
En effet, la valorisation de la créativité et du talent individuel, l'importance accordée à la richesse de chaque individu sont particulièrement mises en avant dans le développement de la nouvelle économie. Celle ci sacralise la réussite individuelle, rapide, explosive, face aux carrières traditionnelles à l'évolution plus, longue et plus lente. Logiquement les mots clés qui caractérisent l'univers de la nouvelle économie sont plébiscités : bourse, Internet, concurrence, profit, renvoient à des évocations positives aux yeux d'une grande majorité des français (enquête les nouvelles frontières politiques de la France).
Cela implique logiquement une attente différente des consommateurs vis à vis des marques. Ils veulent se reconnaître, s'identifier, dans le produit, le service qu'ils achètent ou son image. La tendance est particulièrement forte dans le domaine des services, où les consommateurs exigent une prestation de plus en plus individualisée. C'est vrai dans le domaine du téléphone, d'Internet où l'on compose à son grée sa page personnelle, c'est aussi vrai dans le domaine des loisirs et du tourisme où les consommateurs recherchent de plus en plus un service à la carte, adapté à leurs besoins et leurs moyens. Cette réalité se manifeste encore dans le soutien des français à la réduction du temps de travail et leur volonté de mieux articuler temps personnels et temps professionnels. Cette exigence va jusqu'à concerner les services publics vis à vis desquels les Français demandent plus d'efficacité mais qu'ils s'adaptent à leurs besoins individuels.
Illustrations · Comportement électoral des français affranchi de la filiation, affranchi pour les femmes de l'influence du mari…· Facture Télécom individualisée· Offre TV Satellite individualisée· Page personnelle sur le Web· Temps de travail à la carte· Remise en cause des modèles statistiques de Bison Futé en raison d'une organisation des loisirs et des vacances à la carte.
III. LA LIBERTE : MOI, COMME JE VEUX, ET CHACUN COMME IL VEUT
Les Français sont de plus en plus tolérants dans la sphère privée. Ils considèrent que la société n'a pas à leur dicter leur conduite dans la vie privée. C'est la conséquence de 'l'individualisation des valeurs'. Ils revendiquent un épanouissement sans entrave, qu'on leur laisse vivre leur vie privée comme 'bon leur semble'. Aussi, l'opinion porte de moins en moins de jugements de valeurs sur les comportements d'autrui.
Dit autrement, le 'contrôle social' s'estompe et des comportements qui auraient été jugés déviants auparavant ne le sont plus. Même si les sarcasmes et certains préjugés subsistent, l'homosexualité est chaque année un peu plus acceptée ; la contraception fait consensus et l'avortement ne suscite l'opposition que d'une frange très minoritaire de la population ; les formes d'union autres que le mariage sont largement banalisées. Toutes les enquêtes montrent que la société française évolue vers moins de rigorisme dans la sphère privée.
Cela explique aussi la distanciation prise par les français vis à vis de la morale religieuse. Si les français restent attachés à la spiritualité, ils demandent à la religion qu'elle ne codifie plus leur vie de tous les jours. La montée du courant libéral de l'église catholique en est une illustration. L'intérêt croissant vers les religions de type bouddhiste qui accordent une place importante à l'harmonie individuelle sont aussi un signe de la libéralisation des comportements qui accompagne l'individualisation des valeurs.
Cette libéralisation trouve un écho paroxystique dans la transgression des codes moraux traditionnels. On constate dans les enquêtes réalisées sur les prescripteurs de tendance, la volonté de bafouer les interdits d'affirmer une identité rebelle, déviante. Les hakers s'affirment parmi les icônes les plus reconnus de cette mouvance.L'émergence d'attitudes qui consistent à afficher des symboles jusqu'ici représentatifs du mauvais goût et du vulgaire, renforcent ce goût pour le ' politiquement incorrect ' et la rébellion.
Illustrations · Hakers, symbole de la rébellion contre e système· Développement des tatouages, du piercing· Détournement des marques telle Lacoste, aujourd'hui vêtement préféré des jeunes des quartiers dits difficiles.
Toutes les barrières sont cependant loin d'être tombées. On arrive là à la quatrième grande tendance.
IV. LES SECURITES : SUR DE MOI, INQUIET DEHORS
La croissance a simultanément apaisé la crainte collective du chômage, libéré les ambitions individuelles et fait naître de nouvelles angoisses. Le monde qui s'ébauche sous les yeux des français leur apparaît fascinant et inquiétant en même temps : prometteur de connaissances nouvelles, de développement et d'épanouissement et parallèlement, générateur d'inégalités et d'insécurités nouvelles. Ce sont ces menaces qui s'esquissent, ces insécurités qui émergent qui alimentent principalement ce nouvel univers d'inquiétude des Français.
Conséquence : dans la sphère économique comme dans celle du social, les Français rejettent l'absence de règles, de normes et craignent par-dessus tout, la loi du plus fort. La première demande est évidemment une demande de sûreté et de sécurité physique. Mais ce besoin de sécurité dépasse la seule question de la lutte contre la délinquance ou les incivilités : l'opinion est de plus en plus soucieuse de sécurité alimentaire bien sûr et de sécurité sociale au sens large du terme.
Il y a en fait dans l'opinion, particulièrement au sein des catégories les plus fragiles, un fort besoin de protection. La crainte de l'avenir se manifeste sous la forme d'une crainte d'une évolution non maîtrisée du progrès technique, scientifique et technologique. Ce sentiment est manifeste dans l'aspiration à davantage de sécurité environnementale.
Si les Français souhaitent que leur environnement soit protégé des risques, il y a aussi, derrière cette attente, une aspiration plus large à une meilleure qualité de vie (qualité de l'air, amélioration des transports, meilleure articulation des temps sociaux, animation de la ville…), particulièrement vivace chez les jeunes, les urbains et les classes moyennes et moyennes supérieures. Le label 'safe' est plus que jamais d'actualité.
Cette transformation dans la hiérarchie des peurs touche la plupart des pays développés. Cependant, la France continue à exprimer une certaine singularité et montre toujours une sensibilité plus forte aux problèmes d'exclusion sociale et d'environnement. C'est une interpellation directe des entreprises et des pouvoirs publics. Vis à vis des marques cette demande de sécurité est claire et se caractérise par la méfiance vis à vis des produits dont l'origine et la traçabilité sont douteuses. On recherche la transparence dans les modes de production, la clarté dans toute la chaîne de distribution. Il ne s'agit plus d'un paramètre périphérique dans la démarche du consommateur. Cette exigence est devenue centrale. C'est la cinquième tendance.
V. CONFIANCE : MOI J'AI BESOIN DE SAVOIR
Dans le rapport à la consommation, aux marques et aux produits, les consommateurs français montrent une sensibilité croissante aux attitudes ' morales '. L'éthique de la marque est valorisée, la relation de confiance privilégiée. L'intérêt pour l'origine des produits, les conditions économiques qui ont participé à leur production constituent des vecteurs puissants d'image et d'attraction.
Cette exigence est conforme à un phénomène que nous constatons depuis plusieurs années dans l'évolution des valeurs des français. La demande d'ordre et de régulation est forte dans le domaine social. Les Français estiment ' qu'il y a des choses à respecter ' et expriment un fort besoin de civisme et d'éthique. C'est une exigence qui irrigue l'ensemble de la société.
Le consommateur n'est pas un individu myope, l'œil concentré sur le produit, sa conscience en sommeil. Il développe une forme d'éthique de consommation qui s'accommode mal d'une logique de production qui bafoue les droits fondamentaux. Mais cette vigilance ne s'exerce pas seulement vis à vis des entreprises qui solliciteraient le travail des enfants ou des détenus à l'étranger, elle inspire aussi la défiance à l'égard des entreprises inciviques sur notre sol. Le Crédit Lyonnais ou Total ont pu en faire l'expérience. A contrario, l'exceptionnelle mobilisation d'EDF et de ses salariés pour faire face en première ligne aux conséquences de la tempête en décembre 1999, symbolise l'attente des français à l'égard des entreprises, une exigence qui supporte de moins en moins que les logiques financières s'affranchissent des exigences du progrès social et du développement durable.
Les Français veulent connaître les coulisses du produit. La transparence que garantit une marque consolide la confiance des consommateurs. Cette réalité est déjà sensiblement prise en compte par les marques. Ce palmarès en témoigne en mettant en lumière l'affirmation d'un nouveau marketing de l'offre. Les entreprise et les marques prennent la parole, ne se retranchent plus derrière la demande des consommateurs, et affirment une stratégie, affichent clairement leur identité et celle de leur produit.
Illustrations · Crise de la vache folle· Dégringolade de l'image Total Fina après la catastrophe de l'Erika· Multiplication des chartes sociales s'engageant à refuser le travail des enfants ou celui des prisonniers· Développement des appellations d'origine.
VI. PROXIMITE : PROCHE DE MOI ET DE MON HISTOIRE
Cette exigence d'éthique s'accompagne d'un attachement des consommateurs aux marques qui ont fait leur preuve dans la durée. Dans un paysage en perpétuelle mutation, les consommateurs réclament des points de repères. Ils veulent connaître les coulisses du produit. Dans la relation directe au produit, ce souci de réassurance se traduit notamment par l'essor des labels qualités, des mentions 'saveur ou produit de l'année'.L'ancrage d'une société dans la vie économique, la pérennité d'une marque sont déterminants dans la confiance accordée par les consommateurs.
Dans une société de consommation ou l'éventail des marques est souvent l'objet de transformations consécutives aux bouleversements des structures des entreprises (fusions, acquisitions), dans une société où émergent brutalement produits et marques nouvelles pour disparaître aussi rapidement, les consommateurs expriment une forte attirance pour les marques qui rassurent, qui ont installé dans la durée leurs compétences, la reconnaissance de la qualité des produits ou des prestations.
On cherche à comprendre et à décrypter la 'personnalité' de l'entreprise ou de la marque. Tout cela privilégie la dimension du rapport au temps qu'entretiennent les entreprises, notamment dans la maîtrise de leur savoir-faire. Les entreprises 'patrimoine' (Danone, Perrier, PSA, EDF ) en profitent. Le succès récent de la campagne 'l'artisanat, première entreprise de France' renvoie à l'attachement des consommateurs pour les choses 'bien faites', les produits 'qu'on connaît'.
En toile de fond, la société répercute des signaux qui soulignent le retour en grâce des divertissements, loisirs, modes qui renvoient à l'enfance ou au passé. La vogue de l'humour régressif (South Park), des soirées ' branché-ringard ', le succès de radio nostalgie, la valorisation de la spontanéité, de l'insouciance, d'un style d'être naïf et enfantin précisent cette recherche qui puise dans le passé les arguments pour se sentir bien et se rassurer. Dernier épisode en date de cet attachement aux valeurs ' sûres ', la mobilisation réussie des auditeurs de RTL en faveur du retour de Philippe Bouvard à l'antenne.
Dans la relation de confiance qu'il entretient avec l'économie et la société, le 'citoyen consommateur' est de plus en plus sensible à la relation de proximité avec l'univers concerné. On rejoint là l'importance donnée à la relation de confiance avec celui qui produit ou qui propose un service. Cette sensibilité à la proximité favorise considérablement l'attrait et l'attachement à la marque, aux entreprises, aux acteurs d'une manière générale. C'est bien sûr également vrai dans le domaine politique …
Il faut resituer ce désir de proximité dans une évolution plus globale des valeurs des Français. En effet, les Français investissent de plus en plus dans les relations familiales, amicales, professionnelles. Plus que jamais les Français cultivent leurs relations proches. Le lien social est plus vivace que jamais mais passe moins par les idéologies et beaucoup plus par les relations interpersonnelles. On demande désormais, à une marque, un produit, qu'il se fonde davantage dans l'univers quotidien.
Il faut interpréter cette tendance comme une réaction aux rythmes de vie ultra-rapides de la société moderne, à la 'surinformation'. Il s'agit là d'une forme de refus des relations impersonnelles liées à la culture urbaine. En outre, la mondialisation inquiète les Français et renforce la quête d'identité, la recherche de racines. Jamais la revendication identitaire régionale n'a été aussi forte en France. Les mouvements culturels régionalistes n'ont jamais connu un tel engouement. Le renouveau auprès des jeunes des bals 'folk' ou des fêtes traditionnelles en Bretagne en est un exemple. Dans la même veine, l'adhésion nombreuse des jeunes aux causes défendues par José BOVE, pourfendeur de la ' mal-bouffe ' et de la mondialisation, défenseur des produits du terroir, l'essor à l'occasion des élections municipales des listes ZEBDA, revendiquant une citoyenneté de proximité, sont caractéristiques de cette tendance.
L'attrait pour les grands espaces, pour la nature, pour les produits ' bio ' confirme le regain d'intérêt des français pour la simplicité, ce qui est ' naturel et authentique'. Ce qui est proche est connu, donc plus transparent, plus palpable, plus rassurant. Ce mouvement souligne donc la nécessité pour les marques de réduire au maximum la distance qui les sépare du consommateur.
Illustrations ANCRAGE· Très bonne image des entreprises EDF, GDF, Perrier, PSA, Renault…· humour régressif ' South Park '· Mode des soirées branchés ringards· Succès de radio Nostalgie· Mobilisation en faveur du retour de Philippe Bouvard à l'antenne· Renouveau des prénoms d'origine régionale en Bretagne ou en pays BasquePROXIMITE· Succès de la campagne ' l'artisanat, première entreprise de France '· Listes ZEBDA porteuses de l'exigence d'une citoyenneté de proximité· L'attente des français vis à vis de leur maire, qu'il soit là ' depuis longtemps '.· Campagne France 3 : ' De près, on se comprend mieux '
***
Pour conclure, depuis deux décennies, la société française est traversée par un double mouvement contradictoire : une progression de la tolérance dans la sphère privée d'une part ; un besoin grandissant d'ordre et d'autorité dans la sphère sociale, d'autre part.
De ce paradoxe naît un individu, citoyen et consommateur, tolérant, soucieux de satisfaire ses besoins individuels dans une relation fondée sur la proximité et la confiance, dans un environnement protégé et régulé.
Nous avons retenu de cet individu que ses besoins, ses exigences, ses valeurs se structuraient désormais selon des principes et des règles plus individualisés que dans le passé.
Cela fonde un principe d'infidélité à l'égard des marques et des produits qui modifie à terme le rapport à la publicité et la vocation de celle-ci.