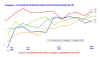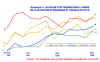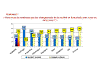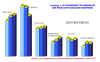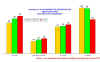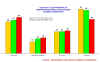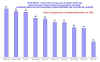L'Europe politique face à la nouvelle opinion
Avec partout en toile de fond le retour tant espéré d'une conjoncture économique favorable, l'Europe a connu, en 1999, des événements et des secousses historiques. L'actualité de l'Europe, celle qui circule dans tous les pays de l'Union au-delà des frontières, dispose ces derniers mois d'une imposante rétrospective : la création de l'euro, la crise de la Commission de Bruxelles, la guerre au Kosovo, les élections européennes du mois de juin, et les derniers épisodes de la crise de la vache folle. Le début de l'année 2000 n'est pas en reste. Le scandale qui frappe la CDU en Allemagne apparaît comme un épisode de plus dans le processus de crise des structures démocratiques européennes et pose la question de l'avenir des relations entre le pouvoir politique et la sphère économico-financière. La venue sur le devant de la scène politique autrichienne de l'extrême droite populiste est également un symptôme révélateur de l'incapacité des milieux politiques traditionnels à proposer des réponses intelligentes aux réactions identitaires des peuples.
Au-delà de l'actualité nationale des pays de l'Union, la mondialisation et son nouveau média symbole, l'Intemet, se sont imposés partout, scandant déjà la naissance d'une nouvelle société. Actrices ou spectatrices de cette période révolutionnaire, les opinions d'Europe sont ainsi entraînées dans un mouvement fait de profondes mutations qui constituent autant d'inconnues sur l'évolution des comportements politiques et sociaux. Face à ces mutations, elles attendent du pouvoir politique qu'il puisse répondre à trois questions relatives aux conséquences de la nouvelle économie :
- Comment répartir ses richesses nouvelles ?
- Comment faire face aux violences et aux insécurités qu'elle pourrait contribuer à développer ?
- Comment préserver les repères identitaires des vieilles nations d'Europe, qu'elle semble mettre à mal ?
La première mutation est d'ordre économique. L'année 1999 a d'abord consacré le rétablissement spectaculaire du moral des consommateurs. La confiance des consommateurs européens dans la situation économique a gagné 24 points en Europe depuis la fin 1996 dont 8 points sur la seule dernière année 1999, et le pessimisme dans l'évolution du pouvoir d'achat a, dans le même temps, connu une baisse très significative passant en Europe de 49 à 35 % (1). En 1999, le rythme de rétablissement de la confiance individuelle dans la progression du niveau de vie a été variable selon les pays. Très imposant en France (+ 17 points), en Grande-Bretagne et en Espagne (+ 10 points), il a été plus modeste en Italie (+ 2 points) et en Allemagne (+ 1 point). Dans la plupart des pays du Vieux Continent, les consommateurs sont désormais une majorité à anticiper de manière positive la marche de la conjoncture. Le regard détaillé sur ces données européennes frappe par la force et la rapidité de la tendance. A la fin de l'année 1999, les écarts de confiance personnelle dans la progression du pouvoir d'achat ont été réduits de moitié (2).
Graphique
1 : Solde de confiance dans l'évolution du niveau de vie
Cette harmonisation ne peut masquer d'importantes différences fondées sur des critères socio-économiques. L'amélioration du moral des consommateurs s'est opérée de manière beaucoup plus prononcée parmi les classes moyennes et l'écart de confiance s'est creusé au détriment des bas revenus (graphique 2). A la fin de l'année 1996, 10 points séparaient le niveau de confiance des catégories à revenus moyens inférieurs de celui des populations disposant de ressources modestes. Cet écart est désormais de 28 points. Tous les indicateurs qui mesurent la perception du champ économique attestent du même phénomène : pour l'instant, l'Europe des bas revenus n'a que très partiellement ressenti les effets du retournement de conjoncture. Plus préoccupant encore, l'accentuation des contrastes sociaux semble être le trait caractéristique saillant de l'évolution des opinions.
La vision qu'ont les Européens de l'avenir de la situation économique et sociale de leur pays est, à ce titre, particulièrement éclairante. Le rythme de progression de cet indicateur apparaît beaucoup plus accidenté et lent, et les divergences de tendances nationales perdurent (graphique 3). Il est stagnant mais demeure supérieur à la moyenne de l'Union en Grande-Bretagne, en ascension spectaculaire en Espagne, toujours négatif en Italie, préoccupant en France, et surtout en Allemagne, signe que les malaises sociaux sont, dans ces pays, loin d'être apaisés. Dans cet environnement nouveau, la situation de la France est représentative de ce que montre l'Europe dans sa version agrégée. L'ère de la nouvelle économie a - semble-t-il - commencé à fabriquer dans notre pays des écarts importants dans la croyance d'un avenir économique meilleur.
Graphique 2 - solde de confiance économique en Europe
selon le niveau de revenu
Plus que chez nos voisins, les contrastes sont aujourd'hui plus accusés entre hommes et femmes, au profit des premiers, entre jeunes et plus âgés, entre diplômés et citoyens à faible niveau d'instruction.
Graphique 3 - Solde d'optimisme dans l'avenir de la situation
économique et sociale du pays
Alors que les franges les plus aisées et les classes moyennes les plus favorisées considèrent l'avenir économique dans leur majorité avec optimisme, près des deux tiers des classes populaires et défavorisées continuent à " broyer du noir " et plus de la moitié reste convaincue que " la situation du pays reste mauvaise ". En cinq ans, la désormais célèbre fracture sociale a pris du relief. A terme, l'évolution du moral des catégories de population les plus exposées aux difficultés économiques constitue un facteur crucial de stabilité du climat politique et social, surtout si l'on fait l'hypothèse que le processus de révolution économique en Europe va aller en s'accélérant, avec la perspective de l'arrivée de l'euro en janvier 2002.
La première année d'existence de l'euro n'a pas contribué à renforcer la crédibilité de la nouvelle monnaie auprès des populations européennes. Son lancement n'a pas fait taire les inquiétudes des consommateurs. Si la France a rejoint les pays du Sud de l'Europe dans une adhésion d'un exceptionnel niveau, Allemands et surtout Britanniques accordent une bien faible marge de confiance à l'euro. En l'espace d'un an, l'adhésion à l'euro a reculé de 3 points outre-Rhin et de 5 points outre-Manche (3). Plus préoccupant encore, parmi les classes sociales les moins favorisées, la chute est de près de 30 points dans les deux pays : une majorité de ces catégories rejette l'euro. Associé aujourd'hui à la reprise de la croissance économique, l'euro ne fait pas vraiment figure, en France aujourd'hui, d'enjeu de débat. Aucune catégorie sociale ne conteste la décision prise lors du sommet européen de Bruxelles de mai 1998. Néanmoins, la distance et l'indifférence des Français à l'égard d'un sujet qu'ils jugent escamoté depuis le déclenchement de la période de transition pourraient contribuer à fragiliser le processus, notamment dans l'hypothèse d'un scénario d'inadaptation importante des populations fragiles.
L'enjeu politique, décisif, qui est en toile de fond du basculement prévu pour le ler janvier 2002, réside dans la capacité des élites politiques, aujourd'hui fort discrètes sur le sujet, à rassurer et à expliquer aux populations européennes ce qui sera sans doute le plus considérable de tous ces changements. Une enquête Ipsos, destinée à cerner le profil psychologique et socioculturel des Européens, conduite l'année dernière, révèle la force de réflexe de résistance au thème du changement, sur- tout lorsqu'il sous-entend des changements conduits " de haut en bas ", initiés par les structures de pouvoir, en vue d'être proposés ou imposés aux citoyens. Ainsi, près de 60 % des citoyens de l'Union ont le sentiment que les changements de la société " se font plutôt sans eux ". La France est le pays où le réflexe de résistance est le plus affirmé.
Graphique 4 - " Avez-vous le sentiment que les changements de la société se font avec ou sans vous ? "
La seconde mutation est sociétale. Elle s'opère alors que les modes de vie sont en train d'entrer dans une autre époque, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique. Doublement concerné, le thème du travail est révélateur. La modification des échelles de temps et d'espace, conséquence de la révolution technologique de l'Internet, va transformer la carte sociologique des statuts socioprofessionnels, fragilisant de plus en plus les populations les plus inadaptées, à la recherche de sécurités multiples, et installant chez de nouvelles générations d'actifs intégrés des habitudes et des modes de vie nouveaux. L'accès à Internet devrait devenir très vite un critère discriminant décisif des attitudes et des opinions. Synthèse de critères comme le niveau d'instruction, le niveau de revenus, l'activité professionnelle, l'appartenance à une génération, il est aussi le reflet d'une nouvelle relation au monde et à la société. Si l'on se réfère à l'exemple français (un peu plus de 10 % des foyers connectés), il divise aujourd'hui la population française en deux catégories, de très inégale importance. Mais qu'en sera-t-il lorsque nous atteindrons des niveaux de connexion proches de ceux des États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire 50% ? Cette nouvelle fracture potentielle est en train d'intervenir au moment où le champ des préoccupations collectives connaît, lui aussi, une période de transition marquante.
Au moment où nous opérerons cette révolution sociologique, l'Europe des années 2000 sera-t-elle dominée par la préoccupation sécuritaire ? Oui, si l'on en juge par l'orientation des indicateurs qui mesurent l'évolution des principaux problèmes qui inquiètent les opinions en Europe. Lors de la dernière vague d'enquêtes des " tendances des opinions publiques européennes ", réalisées par Ipsos à la fin de l'année 1999, pour la première fois l'insécurité et la violence sont devenues la principale inquiétude des Européens (graphique 5).
Ce renversement dans l'ordre des préoccupations s'explique par un double phénomène. La baisse du chômage à un rythme accéléré a libéré un espace pour d'autres enjeux. Par ailleurs, les pays concernés ont été confrontés depuis plusieurs années au problème de l'insécurité urbaine, génératrice d'inquiétude croissante chez les citoyens. Concentrée longtemps parmi quelques catégories comme les personnes âgées, l'insécurité s'impose aujourd'hui dans toutes les générations et tous les milieux sociaux.
En réalité, c'est à un vaste mouvement de rééquilibrage auquel on assiste depuis plusieurs mois: avec l'insécurité, l'exclusion sociale, la lutte contre l'immigration clandestine, les problèmes d'environnement sont des inquiétudes qui progressent dans tous les pays d'Europe, à des rythmes variables, fonction de la topographie locale des enjeux.Ils seront les thèmes de l'Europe de demain. Au-delà de l'observation comparative internationale, une lecture sociologique détaillée permet de mieux saisir l'importance de ce renversement. L'insécurité est devenue la principale préoccupation des employés et des ouvriers européens (graphiques 6 et 7) et, corrélativement, elle est devenue aussi la première préoccupation de l'électorat de centre gauche ! Ce nouvel objet d'interrogation collective a eu pour première conséquence de provoquer partout en Europe une lente dégradation de la confiance accordée par les citoyens aux gouvernements pour lutter efficacement contre l'insécurité et la délinquance. Elle a contribué également à générer une attente permanente de réassurance contre la notion de risque. C'est ainsi qu'il faut interpréter le " réflexe sécuritaire " qu'expriment les Français lorsqu'on les interroge sur leur vision de l'avenir de l'Europe. Ils citent alors prioritairement les fonctions régaliennes de police, de justice et de défense (4), à leurs yeux de plus en plus mal assurées et assumées.
Graphique 5 - Le changement de hiérarchie des préoccupations des Européens (en %)
Graphique 6 - Le changement de hiérarchie des préoccupations des employés européens (en %)
Graphique 7 - Le changement de hiérarchie des préoccupations des ouvriers européens (en %)
Si les Européens continuent aujourd'hui en majorité à regarder avec inquiétude l'avenir de leur société, on le doit beaucoup à l'incapacité d'adaptation de la sphère politique à prendre la mesure de toutes ces mutations. Ce phénomène de distanciation a trouvé une ultime illustration à l'occasion du dernier scrutin européen. Jamais le décalage n'avait été aussi important entre le climat d'indifférence de la campagne et l'importance de la séquence historique que connaît actuellement la construction européenne. Dans une démocratie européenne " adaptée ", le scrutin de 1999 aurait dû être celui du trop plein d'enjeux et donc marqué par un intérêt fort et croissant des électeurs.
Tôt ou tard, les dirigeants politiques des pays de l'Union devront remettre en cause la nature de la relation future entre le pouvoir européen et les citoyens, c'est-à-dire celle qui se manifeste à travers le choix des électeurs. Les élections européennes dans leur mode d'organisation actuelle ne résisteront pas à l'abstention record le 13 juin. Au-delà de l'épisode électoral du printemps dernier, pour de nombreux citoyens d'Europe, cela n'est plus simplement l'Europe qui souffre d'absence de lisibilité, c'est la fonction du pouvoir politique qui est en cause, alimentée par la difficulté croissante à identifier les frontières entre la gauche et la droite. Face aux questions posées par la montée prévisible des enjeux " sociétaux ", droite et gauche devront redéfinir les frontières de ce qui les oppose. À ce titre, les droites européennes, face au double mouvement de la mondialisation et de la construction de l'Europe, sont déjà et seront de plus en plus confrontées à une crise d'identité. Si l'on excepte le cas italien, traditionnellement très attaché à l'idée européenne, les électorats de droite sont, dans tous les autres grands pays d'Europe, majoritairement sensibles aux réflexes souverainistes. C'est l'une des conclusions importantes de l'enquête préélectorale menée en mai 1999 pour mesurer les motivations des électeurs (graphiques 8 et 9) (5). Si le réflexe souverainiste est également présent à gauche, en Grande-Bretagne bien sûr mais aussi au sein des électorats de gauche en France et outre-Rhin, la sensibilité " européiste " est bien un trait caractéristique des électorats de gauche et social-démocrate. Pour cette raison, ce clivage est sans doute promis à un grand avenir car la politique, comme la nature, a horreur du vide.
Face au nouvel espace économique mondial et dans la perspective d'un poids toujours plus imposant du pouvoir européen, l'éventail modéré des échiquiers politiques nationaux devra progressivement intégrer ce qui sera la troisième mutation, d'ordre politique, qui touche à la préservation des espaces de souverainté et d'identité. Elle permettra aux électeurs d'identifier à nouveau les frontières entre deux grandes familles politiques, condition décisive de la clarté des alternances.
Graphique 8 - l'adhésion des électorats modérés au renforcement des pouvoirs de l'Europe (en %)
Graphique 9 - L'adhésion des électorats modérés
à l'idée souverainiste (en %)
(1) Indice européen de la consommation Ipsos-Sofinco.
(2) Les tendances des opinions européennes-Ipsos novembre 1999. Enquête trimestrielle sur les tendances des opinions politiques, économiques et sociales dans les principaux pays européens auprès d'un échantillon de 5 000 personnes.
(3) Ibid.
(4) " Les Français et l'Europe ", Baromètre annuel Ipsos réalisé pour le ministère des Affaires européennes. Octobre 1999.
(5) Enquête WorldMedia et Libération. 6 717 électeurs du 7 au 11 mai 1999.
Cette analyse est également parue dans L'Opinion Européenne, sous la direction de Bruno Cautrès et Dominique Reynié, Presses de Sciences Po