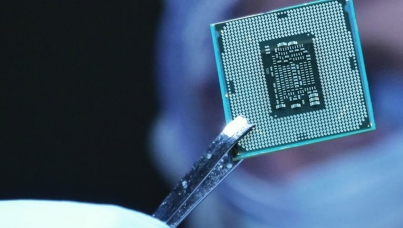Risques auditifs : Les jeunes font encore la sourde oreille
LE DENI COMME PREMIERE JUSTIFICATION D’IMMOBILISME, DE NON-ADOPTION PARTIELLE OU SYSTEMATIQUE DES GESTES DE PREVENTION PAR RAPPORT A SON AUDITION
Parmi les raisons le plus souvent mises en avant (multi-réponses) : le fait de "ne jamais avoir eu de problèmes d'audition" (42%), de "ne pas avoir envie de s'imposer des contraintes supplémentaires" (28%), de "se dire ne pas être suffisamment sensibilisé aux risques potentiels de troubles auditifs" (26%) et de "penser que les troubles auditifs arrivent plutôt aux personnes plus âgées" (16%).
L’omniprésence au quotidien du bruit semble acceptée, elle est même considérée comme rassurante, peu sujette aux critiques au premier abord. Le bruit s’oppose au silence qui s’apparente à la nuit, parfois à l’angoisse, à la mort. La relation au bruit est émotionnelle, l’acceptation du bruit est plutôt liée à son propre état d’esprit, à son humeur, au contexte plus qu’à des éléments d’évaluation objectifs. Alors que sur le plan sémantique, le "bruit" s’ancre d’emblée dans un registre négatif et se définit comme une nuisance, il s’oppose à la notion de "son" qui, lui, est spontanément relié à la musique, à la notion de plaisir. Dans cet univers évocatoire, l’audition est appréhendée d’abord sous l’angle rationnel, c’est ce qui permet d’écouter, d’entendre, de comprendre mais quand l’audition est abordée sous l’angle du dysfonctionnement, une distanciation se créé immédiatement avec le stéréotype "les problèmes d’audition c’est pour les vieux".
Passif et attentiste peut être aussi qualifié le comportement des jeunes suite à une douleur dans l’oreille ou sifflement ou bourdonnement ou perte brusque d’audition. En effet, en pareil cas, pas moins de 59% déclarent n’avoir rien tenté mais avoir simplement attendu que cela passe, alors que 22% déclarent en avoir parlé à leur entourage et seulement 14% avoir consulté un spécialiste ORL ou 5% un médecin généraliste. En outre, 9% disent avoir consulté un site Internet spécialisé.
POURTANT LA SENSIBILISATION DES JEUNES PROGRESSE
62% des jeunes 13-25 ans reconnaissent avoir déjà vu, lu ou entendu dans les media, ou reçu de la part de leur entourage, des informations et messages de prévention pour protéger leurs oreilles, soit + 8 points par rapport à 2012 (54%).
D’une manière générale, ce sont 65% des jeunes qui se disent sensibilisés (dont 15% "tout à fait" et 50% "plutôt") aux risques potentiels de troubles auditifs que peut entraîner une surexposition au bruit, alors que de leur côté 82% de parents (de 13-18 ans) seraient sensibilisés.
En outre, 24% des jeunes ont déjà entendu parler de la nécessité d’aménager des temps de récupération quotidiens dans la journée (ou au cours d’une soirée) et 39% des parents (de 13-18 ans).
LE PARADOXE A CETTE SITUATION DE RECEPTIVITE MEDIOCRE DES JEUNES, C’EST QUE PRES D’1 JEUNE SUR 2, CERTES A DES DEGRES DIVERS, DIT AVOIR DEJA VECU UN TROUBLE AUDITIF
Suite à une exposition sonore trop élevée (soirée en boite de nuit, concert, écoute excessive du baladeur, soirée jeux vidéo), ce sont 2% des jeunes qui déclarent avoir "la plupart du temps", 19% "parfois" et 28% "rarement", ressenti une douleur dans l’oreille, un sifflement, un bourdonnement ou une perte brusque d’audition.
DES CLES POUR AGIR
Première action de prévention à laquelle adhèrent les jeunes, l’existence d’une application sur smartphone pour mesurer l’intensité sonore et signaler les dépassements de tolérance du lieu où l’on se trouve (31% d’adhésion en 1er rang de citation, et 73% pour les 3 premières actions de prévention citées).
C’est aussi un suivi régulier des capacités auditives qui s’impose (30% d’adhésion en 1er rang de citation, et 79% au total).
Nécessité de durcir le registre de la communication avec des campagnes de communication "choc", campagnes à fort impact et sans tabous pour faire prendre conscience de la vulnérabilité de l’audition humaine, à la manière des campagnes menées en France par la Prévention Routière (22% d’adhésion en 1er rang de citation, et 67% au total).
La diffusion systématique de protections auditives (30% d’adhésion en 1er rang de citation, et 79% au total) est également suggérée. L’usage actuel des protections auditives relève du double constat suivant : aujourd’hui seuls 10% des jeunes ont eu l’occasion d’acheter des protections auditives (bouchons d’oreilles) pour les porter dans les discothèques ou lieux de concert fortement amplifiés, alors que par ailleurs 47% déclarent qu’ils en porteraient systématiquement pendant les soirées si on vous les leur distribuait gratuitement sur place. Cela impliquerait toutefois que les dites protections auditives ou "bouchons d’oreille" considérés aujourd’hui comme ringards, inconfortables, évoluent vers des produits de mode, de séduction (à l’instar des lunettes) et plus confortables.
Enfin, l’école (pendant les cours de SVT) et les visites médicales scolaires et universitaires, constituent un relais incontournable de sensibilisation pour les jeunes.
Fiche technique :
Phase exploratoire qualitative constituée d’un web focus (9 participants âgés de 18-23 ans), suivie d’une enquête CAWI auprès d’un échantillon national représentatif de 600 jeunes de 13-25 ans et d’une enquête auprès d’un échantillon de 301 parents d’enfants de 13-18 ans, selon la méthode des quotas (sexe, âge, PCS et région UDA).