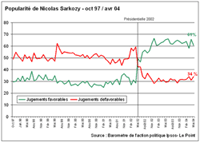Sarkozy, l'exception
Comment expliquez-vous que "l'effet" Sarkozy agisse, à Bercy comme à Beauvau, avec la même intensité?
Pour les Français, le feuilleton continue. Après l'épisode "Sarkozy à l'Intérieur", l'épisode "Sarkozy à Bercy" leur fait découvrir un autre décor, une nouvelle intrigue mais le personnage reste le même. Il a dans la démarche du nouveau ministre de l'Economie et des Finances le même objectif d'imposer un rythme politique, une volonté d'agir et une présence sur le terrain. En imposant cette continuité, Nicolas Sarkozy évite les risques de la rupture d'image consécutive à un changement de responsabilité. Mais il est pourtant trop tôt pour parler d'une dynamique de confiance de même intensité. En 2002, Sarkozy met 5 mois - pour atteindre sa "vitesse de croisière" de popularité, à plus de 60%. Aujourd'hui, il s'agit plus d'entretenir ce niveau et cette image. C'est un exercice de nature différente, plus contraignant. Même si ces premières interventions ont sans doute convaincu, le jugement actuel des Français à l'égard du patron de Bercy reste encore très indexé sur le souvenir de son action à l'Intérieur.
Quelles sont les fragilités du ministre d'Etat?
D'abord celle liée à la nature de la fonction. La popularité acquise depuis 2 ans s'est construite sur l'obtention de résultats : la baisse des chiffres de la délinquance. Le même exercice à Bercy - objectifs de baisse du chômage, d'augmentation du pouvoir d'achat des Français et de réduction des déficits- est plus aléatoire et dépend aussi de facteurs extérieurs. On le voit dans le sondage : la clé résidera dans les mois qui viennent de la confiance accordée sur les terrains du chômage et de la relance de la consommation. Au-delà, il s'agit de démontrer que l'action politique peut encore influer sur le champ économique. Ce n'est pas gagné d'avance quand on sait le scepticisme croissant des Français en la matière !
Seconde fragilité, qui ressemble plus à une contrainte, la gestion du consensus. Ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy disposait avec l'objectif de lutte contre l'insécurité d'un enjeu relativement consensuel. Bercy l'expose plus à la nécessité d'afficher une identité politique et la logique d'un clivage plus affirmé entre gauche et droite. L'exemple du dossier sensible des 35 heures en est l'une des illustrations.
Enfin la gestion du leadership politique. Elle n'est pas sans risque. Finalement après deux ans de présence continue, les Français continuent à être majoritairement convaincus de la nécessité de la démarche médiatique de Nicolas Sarkozy, faite d'omniprésence et d'action ministérielle tous azimut. Mais la recherche du juste point d'équilibre avec l'action proprement politique constituera l'un des clés de l'évolution de son image, au moment où nous rentrerons déjà, avec l'élection à la présidence de l'UMP, dans la phase préparatoire de la future compétition présidentielle. Le fait est révélateur : les sympathisants de l'UMP sont partagés sur ses prises de position concernant l'élection présidentielle, ce qui ne les empêche pas d'être 74% à le croire capable de faire un jour un bon président de la République.
Quelles sont les grandes constantes de sa popularité?
Les niveaux d'abord. La stabilité des bonnes opinions, au dessus des 60% pendant plus d'un an et demi, résistant à toutes les polémiques et controverses. Parmi ces 60%, il faut aussi insister sur l'intensité de cette popularité. 25% des Français ont aujourd'hui une "très bonne" opinion de l'action du ministre. La moyenne de performance de l'ensemble des personnalités politiques sur cette position d'adhésion maximale se situe à moins de 10%.
L'homogénéité politique ensuite. La constance et la proximité des niveaux de popularité enregistrés chez les sympathisants de l'UMP comme de l'UDF n'a pas été remise en cause par les relations entre les deux formations et par le changement de portefeuille ministériel. Enfin, la stabilité de certaines données sociologiques : Nicolas Sarkozy est plus populaire chez les hommes que chez les femmes, moins apprécié chez les jeunes que parmi les plus âgés. La popularité de son action reste en revanche équivalente d'une catégorie sociale à une autre. Au-delà de ces constantes, la modification récente la plus significative concerne l'électorat de gauche. Son image est aujourd'hui plus "clivée" politiquement, Pendant près de deux ans, sa popularité dépassait les 40% à gauche, elle se situe désormais sous ce seuil. Ses prises de position à l'Assemblée au sujet de la lutte engagée par la gauche contre l'antisémitisme peuvent constituer l'une des clés d'explication.
Comment est-il perçu par l'électorat du Front national?
Il est aujourd'hui la personnalité politique la plus populaire après Jean-Marie Le Pen dans cet électorat. Selon le baromètre Ipsos-Le Point du mois de mai, 83% des sympathisants du FN avaient une bonne opinion du leader frontiste. La cote du ministre de l'Economie et des Finances atteint 77%, en constante progression depuis 3 mois. Ce faible écart prend une signification particulière quand on connaît la relation conflictuelle entre les deux hommes et la sévérité habituelle de l'électorat FN pour les personnalités politiques étrangères au Front National. En terme d'image, le sondage fournit une indication intéressante : l'électorat de Jean-Marie Le Pen se singularise par la hiérarchie des motivations de son soutien à l'égard du numéro 2 du gouvernement : ils sont les seuls à privilégier d'abord la dimension de proximité, illustrée par la présence sur le terrain.
La structure de sa popularité le place t-elle durablement dans le club fermé des présidentiables?
Ce n'est pas la popularité qui construit un statut de présidentiable. Dans le sondage, il est rappelé que la crédibilité présidentielle de Nicolas Sarkozy ne dépassait pas 25% en octobre 2002 alors qu'à l'époque son niveau de popularité est identique à celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce niveau de crédibilité est devenu majoritaire. Cette progression, en l'espace d'un an et demi, est, à coup sûr, un phénomène d'opinion inédit sous la Vème République. Elle s'explique essentiellement par l'identification par les Français d'une différence dans la démarche et dans l'action politique. C'est cette capacité de différenciation qui a contribué à créer "de la capacité présidentielle". Mais ce capital est soumis aux mêmes aléas connus par d'autres. Le statut de présidentiable n'est jamais une garantie et sûrement pas suffisant pour être compétitif électoralement. La conquête précoce d'une "présidentiabilité" est souvent un phénomène virtuel et fragile. Michel Rocard, Raymond Barre, Edouard Balladur ou Lionel Jospin s'en souviennent. Une partie de l'évolution d'image et de crédibilité de Nicolas Sarkozy se jouera aussi, s'il est candidat à l'élection présidentielle, dans la confrontation et la concurrence. Ce qu'il faut c'est être là au moment "juste", en phase avec les aspirations des Français et avec l'idée qu'ils se font de ce que doit être un président de la République.