2001 - 2002: état des tendances de l’opinion et de la consommation
Les années 1999 et 2000 ont été significativement marquées Par l'individualisation des valeurs, des référents, des modèles.
Cette tendance a pris un nouveau visage.
On constate d'abord le déclin des modèles et valeurs strictement individualistes
Le fait majeur dont tout découle, celui qui constitue le prisme incontournable au travers duquel on doit comprendre les comportements de consommation et déchiffrer leurs motivations, c'est l'affirmation des français en tant que personne et plus seulement en tant qu'individu.
Quand l'individu n'existe qu'en tant que tel, la personne, elle, existe en porosité et en échange avec son milieu et son environnement.
Le début du 21ème siècle est singulièrement marqué par le déclin des modèles individualistes.
- relecture du culte de la performance à l'aune du temps libre donc du temps pour soi.
- Critique des référents uniquement centrés sur l'individu ( hédonisme, la gratification, la méritocratie…)
- Rejet de la différenciation : la singularisation à tout crin (logomania)en accord avec la volonté d'affirmer sa vraie personnalité.
Ces modèles se sont imposés dans les périodes de crises économiques ou la recherche obsédante de la réussite individuelle, le chacun pour soi pouvait apparaître comme le seul moyen de s'en sortir. Le fracas dans lequel la mode des start-up, exaltant la réussite individuelle, s'est brisée, vient clore bruyamment cette période.
S'inscrivant dans, un environnement économique, technologique plus confortable, les projets de vie de chacun s'orientent vers des modèles simples dans lequel l'épanouissement de l'individu ne se fait ni contre, ni sans mais bien avec les autres.
Naturellement ce désir d'intégration sociale se heurte à une réalité plus complexe, plus brutale.
I. L'affirmation d'un regard critique.
A/ TMBA "There Must be an alternative"
TINA - " There is No Alternative " (il n'y a pas d'alternative), formule assénée de manière récurrente par Margaret Thatcher aux revendications des syndicats anglais ou plus récemment par le FMI à ceux qui contestaient leurs choix, est devenu le symbole de cette pensée mondiale et unique qu'une multitude de citoyens et d'ONG combattent depuis plusieurs années. Objectif : passer du diktat du TINA à l'espoir du TMBA.
Aujourd'hui, 45% des Français estiment que "la mondialisation comporte pour la France plus d'inconvénients que d'avantages", contre 34% d'avis contraires, selon une enquête Ipsos réalisée en novembre 2001.
De José Bové au sous-commandant Marcos les icônes de la lutte anti-mondialisation prospèrent.
2001 aura marqué l'essor de ces combats à travers la contestation des sommets du G8, du FMI ou de l'Union Européenne. Gènes a marqué le paroxysme de cette confrontation, conduisant les leaders mondiaux à se réunir lors de leur sommet suivant dans un palace bunker au milieu du désert.
65% des français partagent en 2000 les positions de José Bové sur la mal bouffe, 51% sur la mondialisation contre18% et 28% qui désapprouvent. Le soutien est donc très fort. (CSA-Le parisien.
Ils sont aussi plus nombreux à envisager la construction européenne comme une menace pour l'identité de la France.
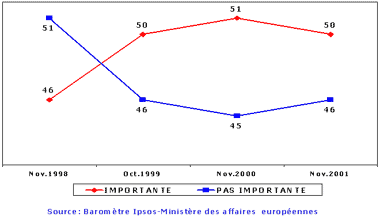
71% des français sont favorables à la taxe TOBIN selon un sondage CSA en septembre 2001.
B/ Chevènement.
Jean Pierre Chevènement, révélation politique de la fin d'année 2001, est le symbole dans la sphère publique de ce regain de contestation des français à l'égard de la mondialisation. L'homme restaure un certain nombre de valeurs revendiquées en résistance à la mondialisation et au déclin démocratique qu'elle signifie selon lui.
54% des sympathisants de la majorité plurielle estiment que Jean-Pierre Chevènement est l'homme qui a le plus d'avenir à gauche en dehors de Lionel Jospin, selon un sondage Louis Harris publié en novembre.
C/2001 année éthique
Les consommateurs expriment une indignation très forte à l'égard des entreprises qui licencient alors qu'elles annoncent des résultats financiers positifs. Cette pratique est absolument incomprise. L'opinion n'accepte pas que l'emploi soit considéré comme une variable d'ajustement comme une autre.
C'est une interpellation directe des entreprises et des pouvoirs publics. Vis à vis des marques cette demande de sécurité est claire et se caractérise par la méfiance vis à vis des produits dont l'origine et la traçabilité sont douteuses. On recherche la transparence dans les modes de production, la clarté dans toute la chaîne de distribution. Il ne s'agit plus d'un paramètre périphérique dans la démarche du consommateur. Cette exigence est devenue centrale.
Les consommateurs français montrent une sensibilité croissante aux attitudes "morales". L'éthique de la marque est valorisée, la relation de confiance privilégiée. L'intérêt pour l'origine des produits, les conditions économiques qui ont participé à leur production constituent des vecteurs puissants d'image et d'attraction.
L'image des grandes sociétés françaises, mesurée par IPSOS dans son baromètre mensuel, illustre cette réalité.
Depuis la catastrophe écologique créée par le naufrage de l'Erika, Total-Elf-Fina ne parvient pas à recouvrer une image positive auprès des Français. Le groupe pétrolier, qui souffre également des multiples rebondissements de la tentaculaire "affaire Elf", encaisse avec l'explosion de l'usine AZF à Toulouse un nouveau coup dur : l'indice d'image (*) chute de 13 points, pour se situer aujourd'hui à un niveau de loin jamais atteint par aucune des 30 entreprises testées depuis deux ans : -40. Deux Français sur trois ont aujourd'hui une "mauvaise image" du groupe, contre seulement 26% d'avis contraire, soit là encore des niveaux records. Même le Crédit Lyonnais, pourtant habitué à l'impopularité, n'a jamais été mesuré aussi bas. Cette banque retrouve d'ailleurs ce mois-ci, grâce à une progression de sept points, un solde d'image à nouveau positif (43% de bonne image contre 42% de mauvaise).
Par contre, ancien mal classé, Danone sort de manière spectaculaire, de la zone rouge. L'avant dernière place enregistrée en septembre dernier, consécutive aux polémiques ayant entourées la vague de licenciements dans certaines usines du groupe (Lu), est déjà un mauvais souvenir pour le géant de l'agroalimentaire.
La forte notoriété de la marque et son investissement très ancien en faveur d'un développement respectueux de l'environnement, de la qualité de vie et de la santé expliquent cette remontée rapide. En outre, Danone demeure considérée historiquement comme une entreprise en avance sur les questions sociales tant par le discours de ses patrons successifs que par la politique sociale conduite par le management en son sein. Danone, malgré l'épisode " Lu ", est considérée comme une entreprise socialement responsable. L'ensemble de ces qualités est sans doute à l'origine du résultat de l'enquête Ipsos/Novethic qui après l'interrogation de salariés, d'étudiants et d'investisseurs, désigne la marque Danone en tête des entreprises éthiques. Ce résultat est d'autant plus important qu'il est réalisé à partir de réponses spontanées.
La bonne performance réalisée par Air France est également à relever. La compagnie aérienne, qui n'a pas, contrairement à bon nombre de ses concurrents, annoncé de lourdes restructurations et de licenciements suite aux évènements du 11 septembre, profite peut-être aussi de l'impact médiatique de la remise en service du Concorde, pour progresser de 13 points en terme d'indice. Deux Français sur trois ont à nouveau une bonne image du transporteur aérien (contre 28% d'avis contraire).
Enfin 2001 consacre une marque ancrée, une marque patrimoniale par excellence, une marque qui rassure, une marque avec laquelle les Français ont envie de se projeter dans l'avenir d'abord parce qu'ils la connaissent : Peugeot.
L'année 2001 aura vraiment été celle de tous les succès pour PSA Peugeot Citroën. Après les titres de voiture de l'année, remporté par la Peugeot 307 et de manager de l'année décerné à son président Jean-Martin Folz, le groupe automobile vient aussi de s'attribuer celui de champion de la croissance, catégorie généraliste. En 2001, il a en effet accru ses ventes mondiales de 11,3 % comparé à 2000.
Peugeot a vu ses ventes mondiales bondir de 13,3 %, à 1,899 millions en 2001, ce qui porte à 58 % sa croissance sur les quatre dernières années
Citroën a accru ses ventes de 8,3 %, à 1,235 millions, singulièrement grâce au succès de la Xsara Picasso.
D/ Les Français passent à l'acte
Cette prise de conscience se transforme de plus en plus en passage à l'acte.
On passe en 2001 du proclamé à l'action. 44% des français à se déclarer prêts à acheter des produits qui respectent les valeurs de l'économie solidaire, 40% prêts à boycotter les produits ne respectant pas ces valeurs. Et 39% prêts à effectuer des dons en nature en faveur d'associations défendant l'économie solidaire. Cette tendance se confirme encore dans une enquête du CREDOC pour le secrétariat d'état au droit des femmes montre que 4 français sur cinq se disent prêts à acheter plus volontiers des produits fabriqués dans des entreprises qui respectent l'égalité entre les hommes et les femmes. Une enquête IPSOS montre que 90% des français est aujourd'hui prête à privilégier, à qualité équivalente, les produits issus du commerce équitable. Surtout la quasi-totalité d'entre eux (86%) persisteraient dans ce choix, tout en sachant que les produits issus du commerce équitable sont parfois un peu plus chers afin d'offrir au producteur un prix plus " juste ".
Désormais le citoyen est consom'acteur. En réalité, il faut de moins en moins chercher à dissocier le consommateur, du citoyen et du salarié. Dernière illustration de ce phénomène en France. Dans un sondage réalisé par Ipsos pour Novethic, 56% des salariés interrogés seraient prêts à démissionner si l'entreprise dans laquelle ils travaillent était à l'origine d'une pollution grave, de pratiques discriminatoires de licenciements…
II/ Demande de protections
Les Français sont inquiets et ils veulent être mieux protégés.
La croissance à l'œuvre depuis 1997 a simultanément apaisé la crainte collective du chômage, libéré les ambitions individuelles et fait naître de nouvelles angoisses. Le monde qui s'ébauche sous les yeux des français leur apparaît fascinant et inquiétant en même temps : prometteur de connaissances nouvelles, de développement et d'épanouissement et parallèlement, générateur d'inégalités et d'insécurités nouvelles.
L'insécurité arrive en tête des préoccupations des français.
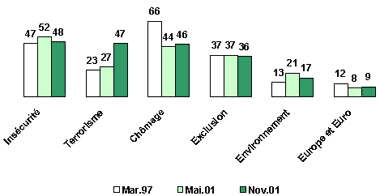
Ces inquiétudes viennent heurter directement la sphère privée.
Les enfants.
61% des français interrogés par Ipsos en septembre 2001 ressentent fréquemment ou parfois Le sentiment de ne pas pouvoir protéger suffisamment leur enfant des influences extérieures (télévision, camarades de classe, centre aéré…).
La santé
Soixante pour cent des Français sont réticents (30 % " très réticents " et 30 % " assez réticents ") envers les organismes génétiquement modifiés (OGM) et méfiants vis-à-vis des informations fournies sur les emballages alimentaires, selon une étude CSA TMO en décembre 2001.
De nouvelles angoisses
Ces angoisses et ses peurs ont pris un nouveau visage, celui, d'une guerre par terrorisme interposé. Fin octobre 2001 54% des français se disaient inquiets concernant les risques d'attentats terroristes commis à l'aide de produits chimiques ou bactériologiques (comme l'anthrax par exemple).
Moins d'achat, plus d'épargne
Conséquence logique de cette insécurité du dehors, le baromètre Ipsos Sofinco montre une dégradation de la confiance des français dans l'avenir de l'économie et se traduit naturellement par une propension croissante à l'épargne plutôt qu'à la consommation.
Actuellement 52% des consommateurs français sont optimistes à l'égard de l'économie de leur pays, contre 44% de pessimistes. Néanmoins, les catégories ayant un solde de confiance négatif restent nombreuses : les femmes (solde de - 3), les catégories d'âge intermédiaires (- 14), mais aussi, de manière plus surprenante, les catégories les plus aisées : le pourcentage d'optimistes dans cette catégorie chute de 32 points, faisant passer - en quelque mois- le solde de confiance de + 59 à -2.
III. la convocation de nouveaux idéaux
A/ L'idéal est dans la réalité.
Génération " ego nomade " : Le réalisme pragmatique
Aujourd'hui loin des idéologies "les ego-nomades" sont en tous points différents de la génération de leurs parents. Ils n'ont pas de références marquantes ni d'expériences communes fortes. Ils ne se revendiquent de rien si ce n'est d'eux-mêmes.
C'est une génération sans combat fondateur. Traversée par le primat de l'individu sur le collectif, cette génération ne cultive aucune sentiment d'appartenance générationnel à l'inverse de leurs parents. Leur patrimoine identitaire est fragmenté et morcelé, tant et si bien que rien ne le résume et que cela explique sans doute le phénomène du no-logo. Ils ne se déclarent nullement les acteurs d'une époque pourtant traversée par des changements rapides et profonds. Ils s'y sentent même plutôt bien et n'en contestent pas les fondements.
Ils ne sont que 6% à vouloir la changer radicalement et pas de 24 % à vouloir la changer sur l'essentiel. Après tout, ils sont d'accord et plébiscitent ce principe selon lequel pour progresser, il faut éliminer " le maillon faible ".
Les " égo-nomades " ont grandi dans un monde matérialiste que leur ont légué leurs parents soixante-huitards. La technologie rythme leur quotidien. Leurs références se sont éloignées des univers idéologiques ou politiques et sont souvent gouvernées par la technologie.
Pour les nouvelles générations, les nouvelles technologies sont des outils pour vivre mais pas des raisons de vivre selon une enquête Euro RSCG World Wide. Les usages de la technologie privilégient la dimension ludique et communicante à la dimension commerciale. Les " égo-nomades " se saisissent des progrès de la technologie pour en faire l'outil de leur propre épanouissement.
Nomadisme et zapping au cœur des nouvelles préoccupations.
" La principale attente des individus est de tout simplifier, réduire rationaliser pour trouver un rythme de vie plus lent. gagner du temps pour pouvoir en perdre…
Interrogés en avril 2001, 66% des français approuvent la réduction du temps de travail. Et d'abord parce qu'ils sont une majorité en France à trouver qu'ils consacrent trop de temps à leur vie professionnelle.
Les Français développent une nouvelle façon de concevoir le temps. Ils acceptent l'impermanence, ont intégré que la constante des choses et de ce qui les entoure, c'est le changement. Promenés dans un univers de consommation en perpétuel mouvement, ils acceptent n'avoir dessus, qu'une prise passagère, deviennent plus infidèles, plus souples, plus pragmatiques aussi.
Les marques prennent de plus en plus en compte la mobilité croissante des individus.
Et elles s'adaptent, l'essor des épiceries automates, du mobilier urbain interactif le succès de la bouteille d'Evian " à balader ", de la trottinette. Le nomadisme, le zapping symbolise cette impermanence et cette infidélité du consommateur
Mais le meilleur symbole trans-générationnel de cette époque nomade, c'est l'essor et le succès de la basket, une basket qui se décline à l'envie selon le clan auquel on appartient. Exemple aujourd'hui : " Puma " pour les filles après " new balance ".
Le bon sens est toujours près de chez soi. Le bon maire aussi.
Le pragmatisme symbolise assez la manière dont les Français ont voté lors des dernières élections municipales.
Deux français sur trois se disent satisfaits du résultat des élections dans leur commune. Electeurs de gauche et de droite partagent ce point d e vue dans des proportions semblables.
Cette satisfaction générale illustre le localisme bien réel du vote. Les facteurs de vote plébiscités sont la personnalité des candidats, leur programme, la situation de la ville, éclipsant totalement l'étiquette politique.
B/ La famille revisitée
Dans une société parfois menaçante, la famille reste une valeur refuge centrale.
Aujourd'hui quand on interroge les Français sur la valeur essentielle qu'il faut transmettre aux enfants : ils indiquent en tout premier lieu, le respect. (sondage IFOP décembre 2001). Loin devant la réussite individuelle, le respect s'impose comme la valeur centrale d'individus qui, à force de voir leur environnement changer, craignent que les règles ne s'effacent. Le monde change vite, les individus aspirent à ce qu'il soit ordonné. Ils demandent qu'il y ait toujours des choses à respecter.
Par effet miroir, on constate que cet attachement à transmettre le respect signifie le désir d'être respecté soi, dans sa liberté d'individu et dans son autorité de parent.
Le désir puissant de famille reste central mais à la différence d'hier, c'est un désir de famille quelle que soit sa forme.
…la famille reste de toute façon un idéal de vie pour tous.
- la famille, une valeur en tête devant le travail, la sociabilité de proximité (amis, relations) et les loisirs, très loin devant la politique et la religion.
- La famille répond à ce besoin vital de racines et de sécurité. Elle reste la seule valeur refuge dans un monde fragile et hostile et favorise l'équilibre de l'individu.
- 74% des français indiquent que la forme de vie idéale est " se marier et avoir des enfants ".
- 71% des français associent d'abord au mot famille, le mot amour. Enquête IPSOS /ça m'intéresse. Mars 1999.
- 72% des français veulent consacrer plus de temps à leur famille dans l 'avenir
Mais l'avènement d'une société de l'individu à une société de la personne a modifié la structure des relations au sein de la famille. Ces relations sont moins verticales, l'autorité patriarcale ne s'exerce plus comme avant. Aujourd'hui s'affirme une famille inter-relationnelle.
Les incidences de la famille inter-relationnelle en terme marketing ont modifié les pouvoirs de prescription au sein de la famille
- Les petits achats sont personnels et relèvent de la prise de décision individuelle
- Les gros achats familiaux font l'objet de décision collégiale, où chacun a voix au chapitre. Il y a négociation et décision collectives. L'achat familial (du robot ménager, à l'achat de la voiture au choix de vacances) devient PROJET FAMILIAL et signe de réassurance (preuve de l 'existence d 'une famille unie). Parfois la famille délègue à celui de ses membres le plus compétent le choix de l'achat collectif : C'est particulièrement vrai pour les jeunes et l'achat de l'ordinateur familial.
C/ bonheur simple et idéal classe moyenne
Aujourd'hui on s'en tient d'abord à soi et au réel. La priorité c'est la volonté d'équilibre et de développement personnel.
Le progrès fulgurant des nouvelles technologies, l'augmentation moyenne et générale du niveau de vie, ramènent - réduisent - l'idéal de vie de chacun à des conquêtes et des objectifs simples.
La société idéale ne fait plus guère recette, l'idéal est dans la vie vécue.
Conséquence on réhabilite le quotidien. Le quotidien est valorisé dans sa simplicité, il est positivé, poétisé. La dernière campagne télé de Coca Cola ou la campagne " Transilien " en sont deux bons exemples. L'ancrage dans le réel, signifie la capacité d'agir donc la capacité de cheminer vers l'idéal. On recherche des moyens d'action concrets, on cultive le goût pour les univers authentiques, naturels. On privilégie le tangible à l'immatériel, le brut au virtuel, les certitudes du lendemain aux hypothèses du surlendemain.
On passe d'un futur rêvé à un réel enchanté. Icône de l'année, le succès du fabuleux destin d'Amélie Poulain. La réalité quotidienne y est lissée pour ne laisser apparaître que la simplicité, l'authenticité des sentiments et des émotions.
Au-delà, on s'enchante pour la real-Télé, la mise en scène de soi à travers d'autres qui nous ressemblent, la possibilité pour le quidam d'occuper la vedette, de devenir une star.
Se développe une sorte d'idéal classe moyenne, un choix de vie en mode mineur qui :
- réévalue les besoins de l'individu à l'aune du vrai, (produits bruts, écologiquement corrects)
- recentre les investissements et la consommation sur l'intérieur, la qualité de vie, (Feng Shui)
favorise l'épanouissement individuel. Campagne Ikéa " rangez " traduit la tendance de la société à vouloir organiser l'espace privé ou public en faveur d'un plus grand épanouissement et d'une plus grande liberté. Le retour en force de la marque Tuperware, symbole du bonheur domestique des années 60 vient confirmer cette tendance.
Cette aspiration à un bonheur simple et tranquille s'accompagne de l'essor de la zen attitude : la spiritualité, l'épanouissement individuel pour le corps et l'esprit.
Une attitude de préservation qui consiste à rechercher/créer des zones de (re)construction spirituelle et physique : des zones " positives " (feng Shui), des zones " sans danger " (cosmétique " naturelle ", alimentation saine ", retour à la terre nourricière " brute ").
Une première réaction vis à vis du " tout technologique " : la ré-injection du spirituel et du sensoriel dans la technologie et le post moderne.
Une tendance présente sous plusieurs formes dans le monde occidental : le Feng Shui en France, la cuisine ethnique et la cosmétique naturelle au Japon, les barres protéinées mais naturelles aux USA.
Cette tendance se retrouve par exemple dans l'habitat.
- Absence de divisions entre les zones
- Extensions de l'habitat, l'intérieur s'ouvre sur l'extérieur, terrasses couvertes, jardins d'hivers. Mariage de styles où se mêlent 1900, futuriste, ethnique, high-tech, années 50, 60, 70.
- Tendance écologique se décline en utilisant des matériaux éco-smart, des matériaux naturels, une architecture organique.
IV. Incidences en consommation
La confiance ébranlée
Au niveau de la consommation, la tendance européenne est à la stabilité. On enregistre peu de variations dans les différents pays européens sur les intentions de consommation. Au contraire, l'enquête confirme plutôt une plus forte propension à l'épargne de précaution.
La tendance est donc à l'épargne, notamment en France, qui semble globalement plus affectée dans les pratiques de consommation que les autres pays européens.
Ainsi, 43% des Français interrogés ont l'intention, "d'essayer de mettre de l'argent de côté" et plus d'un sur quatre pense à "différer des achats".
On peut noter ici que le sentiment de pouvoir mettre de l'argent de côté influence le moral des consommateurs : ceux qui ont le plus de mal à épargner sont aussi ceux qui ont la vision la plus pessimiste de l'avenir économique de leur pays. La perception de l'inflation est un autre indicateur de tendance de consommation : l'Allemagne et la France, sont là aussi en décalage par rapport aux autre pays de l'enquête : 85% des Allemands et 80% des Français interrogés déclarent avoir "le sentiment que les prix des produits qu'ils achètent tous les jours ont augmenté par rapport à l'an dernier".
Ces taux, en forte hausse depuis novembre 1999 (+23 points pour l'Allemagne, + 31 points pour la France), contrastent avec les niveaux orientés à la baisse en Grande- Bretagne (-14 points) et en Italie (-7 points) par exemple. La perception de l'évolution des prix diffère de la réalité économique, mais renseigne sur le moral des consommateurs.
Si la majorité des Européens n'a pas l'intention de modifier ses habitudes de dépenses, l'analyse du comportement des individus ayant l'intention de retarder ou de limiter certains achats, sur une liste de 11 secteurs testés, permet de dégager une hiérarchie des secteurs potentiellement les plus touchés. Ce sont les "voyages de vacances" (31% ), les dépenses "d'équipement audio-vidéo" (25%) ou encore "l'habillement, la mode" (25%) qui risque de pâtir en premier lieu d'un tassement de la consommation. Enfin, quelques semaines avant la mise en place de la monnaie unique, les opinions sur les avantages et les inconvénients de l'euro continuent de diverger.
La consommation contractuelle
Plus que jamais, on est consom'acteur, on négocie avec la marque, on évalue ce qu'on lui apporte et ce qu'elle nous apporte.
Le regard du consommateur devient un regard personnel. Il s'inscrit dans le cadre d'une vision globale intégrant le dialogue entre chaque dimension de la vie de l'individu.
Le regard sur le produit est donc davantage critique, il intègre désormais la politique de l'entreprise comme une des clés qui préside aux choix de consommation.
Le consumer power est né.
Il s'émancipe du pouvoir des marques, il s'affranchit des marques qui assujettissent le consommateur et lui assigne " un mode de vie " (Coca ou Nike)
Il inverse la logique et donne au consommateur du pouvoir sur le marketing des marques.
Il impose des nouveaux critères de choix.
Il déverrouille l'acte de consommation en manifestant par le choix de tel ou tel produit l'attachement à telle ou telle valeur.
Le consommateur envisage la marque comme il souhaite que celle ci l'envisage, dans la globalité de ce qui fonde son existence et sa Personne.
En conclusion, une personne en recherche d'un bonheur simple et accessible…



