Baromètre Accor Services 2004 « Bien être et implication des salariés au travail »
Comme l'écrit Daniel Cohen " le stress devient le mode de régulation de la société post-fordiste. Le travail vivant devient le travail à vif. Et le risque d'être brûlé, burn out, est la limite nouvelle de l'organisation du travail " **.
D'où notre deuxième point de focalisation : les salariés français sont-ils impliqués, " engagés " dans leur entreprise ? Car on pourrait imaginer que cette nouvelle donne génère une moindre motivation, un moindre engagement dans le travail. Or, bon nombre de spécialistes insistent sur ces notions qui seraient des moteurs essentiels de la qualité, de la satisfaction des clients et in fine de la performance globale de l'entreprise. Certains cabinets insistent sur l'attitude en retrait des salariés français en comparaison notamment avec leurs homologues américains, nonobstant les biais culturels qui limitent la portée de quelques-unes de ces études.
Au final, depuis plusieurs années désormais, on évoque de façon récurrente le moral en baisse des salariés français, leur faible implication dans leur travail (parfois aussi leur forte productivité quotidienne…), le malaise plus spécifique de l'encadrement ou encore la relation " mercenaire " qu'entretiendraient désormais les salariés les plus jeunes avec leur entreprise (" ils aiment leur métier, mais rejettent leur entreprise ").... Au gré des analyses un portrait assez inquiétant des salariés français a ainsi été dressé, sur fond de croissance économique molle, de débat sur le temps de travail (" travaille-t-on assez ? "), voire aujourd'hui de délocalisations imputées au manque de compétitivité du système français.
Sans prétendre à l'exhaustivité, le " Baromètre Accor Services " s'est attaché à ces deux notions, le bien-être (est-on heureux au travail ? concilie-t-on vie privée et vie professionnelle ? quelles sont les difficultés que l'on rencontre ?) et l'implication des salariés (se sent-on impliqué dans son travail ? quels sont les facteurs d'implication ?). Le bilan que l'on peut dresser à l'issue de cette première vague du Baromètre Accor Services " Bien être et implication des salariés au travail " est nuancé et donne une image contrastée des salariés français, qui reflète avant tout les mutations qui traversent la société depuis plusieurs années.
Les salariés français sont-ils heureux ?
Un peu moins d'un salarié sur deux (49%) pense effectivement " souvent " " qu'il est heureux dans son travail ", 42% " de temps en temps " et 9% " jamais ". Lorsque l'on demande aux salariés de qualifier leur travail, 16% citent " la fierté " et 28% " le plaisir ", alors que 31% évoquent plutôt " la sécurité ", 16% " la routine " et 8% " la contrainte ". On le voit, on est assez éloigné des scores massifs et unanimistes vus par le passé.
Les salariés les plus heureux ? On les trouve dans le secteur public, particulièrement dans les collectivités locales, mais aussi dans les entreprises privées ayant moins de 100 salariés. Ce qui frappe également, c'est l'écart entre les cadres du public et ceux du privé : près de vingt points séparent les uns des autres en faveur des cadres du secteur public.
Les salariés ont-ils le sentiment de s'impliquer dans leur travail ?
Sur ce point, les résultats sont très partagés : 48% estiment s'impliquer " beaucoup " dans leur travail, tandis que la même proportion dit s'impliquer " suffisamment ". Contrairement à ce que l'on a vu sur la notion de " bonheur ", l'écart entre secteur public et secteur privé est faible. Seul le secteur des entreprises publiques est en retrait par rapport à la moyenne (" s'implique beaucoup " : 37%).
En revanche, sur cette question la catégorie professionnelle est beaucoup plus clivante : plus de 60% des cadres, aussi bien dans le privé que dans le public, déclarent " s'impliquer beaucoup " (particulièrement dans la tranche d'âge 35-49 ans).
Une fois dressés ces premiers constats, on remarque cependant qu'implication ne rime pas toujours avec bonheur au travail et, à l'inverse, que bonheur ne rime pas toujours avec implication. Une " cartographie " plus détaillée permet d'illustrer cette analyse et d'identifier quelques profils types :
En premier lieu, un peu moins de 40% des salariés de notre échantillon parviennent à concilier " bonheur professionnel " et implication (les " fusionnels " et les " épanouis "). Parmi les " fusionnels " (15% de l'échantillon global), on retrouve une forte dominante de salariés du secteur public (collectivités locales) et des entreprises privées de moins de 100 personnes, mais aussi une sur-représentation des employés de plus de 50 ans. Les " épanouis " qui représentent un quart de l'échantillon, regroupent de leur côté un fort pourcentage de cadres et de techniciens/agents de maîtrise du public et de cadres du privé (travaillant notamment dans des entreprises de plus de 5000 personnes). On note aussi une sur-représentation des femmes, plutôt âgées de 30 à 40 ans avec de jeunes enfants.
A l'opposé, les salariés que l'on a qualifié de " en rupture " (8%) ont une attitude extrêmement critique. Ce sont plutôt des salariés âgés (50 ans ou plus) avec enfants, plutôt ouvriers dans le secteur privé. En majorité, ils aimeraient faire un autre travail et pensent " souvent " ou " de temps en temps " avoir envie d'arrêter de travailler. Les " démobilisés " (9%) sont assez proches d'eux, même si l'on trouve dans cette catégorie plutôt des femmes travaillant en entreprises, aussi bien dans le secteur public que privé.
Entre ces deux extrêmes pour lesquels bonheur professionnel et implication sont nettement corrélés, on trouve deux autres types de profils : d'une part, les " désenchantés " (10%) qui bien qu'ayant le sentiment de " beaucoup " s'impliquer dans leur travail, ne sont pas, pour une large partie d'entre eux, " heureux " dans leur travail. Ce sont à nouveau plutôt des salariés âgés, à dominante employés et ouvriers, avec plus de trois enfants à charge et travaillant dans le privé (entreprises de plus + 5000 personnes).
Dans un autre registre, un peu plus d'un tiers de l'échantillon bien " qu'heureux " estime par ailleurs s'impliquer " suffisamment " dans leur travail. Ce sont des salariés que l'on a qualifié de " distants " et de " fragiles ", qui ont pour point commun d'être assez jeunes (moins de 35 ans), d'être aussi bien cadres que techniciens ou ouvriers, et de travailler dans le privé (plutôt dans des entreprises de moins de 5000 personnes).
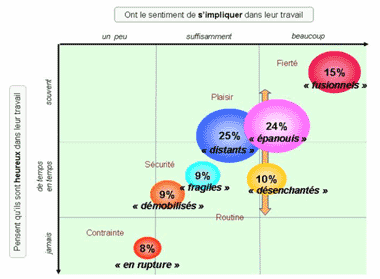
Quels enseignements tirer de cette cartographie ?
Tout d'abord, les salariés qui se déclarent les plus heureux et qui se sentent en même temps très impliqués ont en commun d'être fiers de leur travail. Au-delà des conditions de travail, des relations avec la hiérarchie, de l'autonomie et du salaire, qui sont des leviers d'implication qu'ils partagent avec d'autres, ils sont particulièrement portés par l'image de leur entreprise et de leur métier.
On remarquera à cet égard que ce sentiment de fierté est aussi la caractéristique d'univers professionnels dotés de fortes " cultures " internes, à l'instar de ce que l'on observe dans le service public ou les petites entreprises. Ce point est souvent avancé comme un élément de blocage face aux changements à conduire dans la fonction publique, mais on mesure ici également le bénéfice que cela peut avoir dans la construction d'une relation " harmonieuse " entre le salarié et son environnement professionnel.
Cette composante est en revanche beaucoup moins présente dans les réponses fournies par les salariés des entreprises grandes ou moyennes, qu'elles soient publiques ou privées. Dans cet univers, l'élément différentiant est le statut, en l'occurrence être cadre (de préférence âgé de 35 à 50 ans) ou être non cadre. Etre cadre, ce n'est pas pouvoir nécessairement concilier bonheur professionnel et implication (les cadres les plus jeunes sont souvent nettement plus impliqués qu'heureux), mais en revanche c'est la " garantie " d'être géré. Du coup la différentiation cadre / non cadres est très forte. Les résultats de l'étude le montrent : on trouve dans ces entreprises des pourcentages élevés " d'épanouis ", souvent cadres, mais aussi les plus fortes proportions de " distants ", de " fragiles ", de " démobilisés ", de " désenchantés "…qui sont le plus souvent des salariés non cadres (mais pas uniquement), jeunes ou ayant plus de 50 ans (exemple : 15% des cadres de plus de 50 ans sont dans la catégorie des " désenchantés ").
Au final, les salariés qui témoignent à la fois d'un haut niveau d'implication et de bien-être ont un point commun : ils bénéficient dans leurs univers respectifs d'un cadre de gestion bien défini. Cela est vrai des cadres des moyennes / grandes entreprises du secteur privé : les règles de gestion spécifiques de ces cadres se sont multipliées et se sont professionnalisées. Cela est aussi vrai, dans un registre très différent, pour les salariés de la fonction publique. Au-delà de la sécurité de l'emploi, les règles de gestion de ces salariés sont très formalisées.
Etre " géré " est donc une condition nécessaire pour se déclarer heureux et impliqué…mais pas complètement suffisante. L'impact de la fierté à l'égard de son métier, de son entreprise, on l'a vu, joue à l'évidence un rôle d'accélérateur décisif.
A l'opposé, l'absence d'un cadre de gestion reconnu nourrit deux types de phénomènes : " l'implication mesurée " d'une part, et la " désimplication par réaction " d'autre part. Les " distants " (1/4 de l'échantillon total, en majorité jeunes salariés du privé, cadres inclus), sont assez emblématiques de la première attitude, tant ils estiment s'impliquer ou consacrer " suffisamment " de temps à leur travail (parfois même " trop ").
La deuxième attitude caractérise plutôt des salariés de plus de 50 ans qui estiment aujourd'hui consacrer " trop " de temps à leur travail, voire qui peinent à concilier exigences de la vie professionnelle et contraintes de la vie privée. Ces deux phénomènes, au-delà de l'évolution des esprits, posent clairement la question de l'intégration et de la gestion de la fin de vie professionnelle de ces salariés et soulignent les carences actuelles en la matière. .
Comment l'entreprise peut-elle répondre à ces différents défis, alors que le marché de l'emploi va se tendre pour des raisons démographiques dans les prochaines années ? La réponse semble passer par une prise en compte des besoins individuels transcendant les statuts et les cadres de gestion actuels.
De nombreux spécialistes insistent sur les difficultés que rencontreraient les salariés notamment pour concilier les exigences de leur vie professionnelle et les contraintes de leur vie personnelle. Les résultats du Baromètre Accor Services relativisent la portée de ce problème. Dans leur grande majorité, les salariés interrogés estiment arriver à concilier ces deux dimensions (voir graphique ci-dessous).
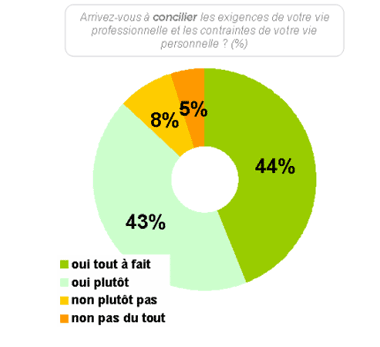
En revanche, plus de 50% des participants à cette enquête, toutes catégories confondues, estiment que leur entreprise " ne prête pas suffisamment d'attention " au respect et à la considération de ses salariés. Derrière cette expression, ne doit-on pas voir l'exigence nouvelle d'une meilleure prise en compte des besoins et des attentes de chacun, à l'instar de ce que l'on observe dans l'univers de la consommation, où la consommation flexible a pris le pas sur la consommation de masse.
Dés lors, l'éventail des cas de figure est très large : pour certains salariés cette demande de prise en compte des besoins individuels va effectivement se traduire par une problématique de gestion du temps et de conciliation des contraintes professionnelles et privées. C'est le cas de salariés jeunes, avec enfants, cadres ou pas, qui évoquent spontanément les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne dus au manque de temps. A leurs yeux une intervention de l'entreprise pour les aider à faire face aux difficultés liées à la garde et l'éducation des enfants leur semble par exemple tout à fait légitime - mais on trouve aussi cette demande chez des salariés plus âgés (les " désenchantés "), qui pour autant n'évoquent pas de problème de temps - cet exemple souligne si besoin était la nécessité d'une approche personnalisée.
D'autres vont en revanche insister sur la prise en compte de leurs besoins de développement professionnel : l'aide à la formation personnelle est le domaine sur lequel l'intervention de l'entreprise est jugé le plus " prioritaire ". On peut y voir le reflet des besoins d'épanouissement individuel, mais aussi l'intégration de la nécessité d'une adaptation permanente de ses compétences dans un monde en mutation accélérée. On remarquera aussi les attentes liées à la sécurisation de l'avenir, épargne salariale, épargne retraite qui elles traversent toutes les catégories de salariés (mais particulièrement les " désenchantés ").
L'enseignement clé réside donc dans cette demande accrue de prise en compte des besoins individuels. Est-ce le seul fruit d'un changement des mentalités ? Assiste-t-on à la duplication dans l'univers de l'entreprise des tendances que l'on perçoit dans la consommation qui obéit de plus en plus à la satisfaction de besoins individuels de plus en plus pointus ? Or face à ces tendances de fond, on peut s'interroger sur la capacité des entreprises à répondre à ces demandes. S'il le fallait, les résultats de cette étude montrent combien aujourd'hui les carences en matière de gestion des hommes sont fortes : après tout " l'implication mesurée " ou la " désimplication par réaction " sont peut-être aussi la conséquence de la non gestion effective de certaines catégories de salariés au cours des dernières années. Mais ils font craindre surtout que les pratiques RH actuelles soient de plus en plus inadaptées face aux demandes croissantes des salariés pour des réponses individuelles à leurs besoins.
* Sondage CSA/ Enjeux les Echos juillet 2003
** Daniel Cohen " Nos temps modernes ", 1999
Quelques chiffres clé :
Fiche technique :
Etude réalisée pour : "Accor Services"
Période d'enquête : Entre le 2 et le 9 juillet 2004 .
Echantillon : 1200 salariés français (hors artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs) âgés de 18 ans et plus.
Méthode : Interviews réalisées par téléphone.




