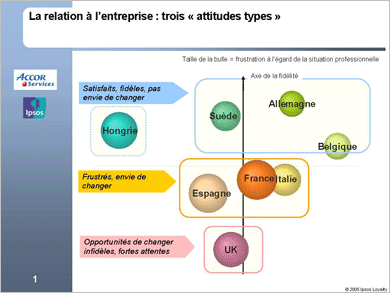Les salariés européens sont plutôt heureux au travail
Accor Services, la division du groupe Accor , a pour vocation d'améliorer la performance humaine des entreprises et des collectivités par des services à leurs collaborateurs clients et citoyens. Dans cette optique, Accor Services a besoin de comprendre en profondeur les attentes des salariés et des entreprises pour concevoir des solutions innovantes améliorant le bien-être des salariés et la performance de l'entreprise.
Accor Services a initié en 2004, en collaboration avec Ipsos, le premier baromètre de l'implication et du bien être au travail en France .

![]()
Dans une société de plus en plus ancrée dans le pessimisme - toutes les études sur le moral des français le soulignent depuis des années - mais aussi stigmatisée pour sa propension à la négativité (un pessimisme ‘génétique‘ avancent certains), il semblait opportun de poser quelques questions clé : dans quelle mesure les salariés français étaient ils heureux au travail ? Se disaient-ils impliqués, quelles étaient leurs attentes ?
A toutes ces questions, les résultats de cette première enquête ont permis de réfuter l'idée d'un rejet de l‘entreprise et du travail par les Français, mais aussi celle d'un amour immodéré de l'entreprise . En lieu et place de ces affirmations que l'on a pu voir régulièrement surgir dans la presse 1, s'est dessinée une relation plus complexe entre salariés et leur entreprise, allant de la relation fusionnelle à la ‘désimplication par réaction' en passant par ‘l'implication calculée'2.
En 2005, Accor Services a souhaité étendre le champ de cette enquête en interrogeant des salariés dans quelques-uns des principaux pays européens - Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, France, Belgique, Suède pour le modèle scandinave et Hongrie en tant que nouvel ‘entrant' sur le marché européen du travail 3.
Une première interrogation consistait à savoir si certains des résultats recueillis en 2004 auprès des salariés Français pouvaient être étendus aux autres salariés européens couverts par cette nouvelle enquête ? A première vue, la réponse est ‘oui'. Sur quelques indicateurs de base, l'impression qui se dégage est celle d' une certaine homogénéité entre salariés européens . Par exemple, on peut affirmer qu'en Europe les salariés sont plutôt heureux au travail. Certes, les Suédois paraissent nettement plus ‘heureux' que les Italiens ou les Allemands. Mais en moyenne, 37% des salariés interviewés pensent ‘souvent' qu'ils sont heureux, 52% ‘de temps en temps', tandis que seuls 9% d'entre eux déclarent ne ‘jamais' être heureux dans leur travail 4.
Quelles sont les composantes de cette ‘ félicité' finalement assez largement partagée ? Le contenu du travail, l'ambiance sont des critères sur lesquels d'un pays à l'autre les salariés se disent en majorité ‘satisfaits' (à 70% environ). Les conditions de travail sont un autre point majeur de contentement. De fait, lorsque l'on fait noter la ‘qualité de vie' au travail, la note moyenne est de 6,3 / 10, avec peu de différences d'un pays à l'autre – seuls les salariés Hongrois donnent une note inférieure à 6, en l'occurrence 5,3. A l'heure où l'on s'interroge sur l'existence d'un modèle européen ou à défaut d'un socle de valeurs et de points de convergence entre européens, on tient ici un élément de réponse, tout au moins pour les salariés.
Cependant, si l'on va plus en avant dans l'analyse, la photographie est nettement plus contrastée . Il parait difficile de parler d'un modèle unique européen, qui pour ce qu'il existe, semble finalement se résumer aux conséquences les plus évidentes, et ô combien vitales pour le moral des salariés, d'un niveau de développement économique assez homogène, qui offre des conditions matérielles et une forme de plénitude ‘professionnelle'… tout du moins pour ceux qui ont un travail.
Au-delà de cette convergence initiale, ce qui domine ce panorama européen, ce sont plutôt les différences que l'on peut percevoir entre pays, dés lors que l'on s'attache à d'autres variables telles que l'implication, l'accomplissement, la relation ou la fidélité à l'entreprise. On voit ainsi se dessiner quelques profils types de salariés, eux-mêmes fruits de modèles socio-économico-culturels qui façonnent sur le long terme la relation que peuvent entretenir les salariés à leur travail et leur entreprise. Quatre profils types ressortent .
En premier lieu, le salarié suédois qui se distingue avant tout par le quasi cloisonnement qu'il semble avoir instauré entre vie privée et vie professionnelle . Moins d'un tiers des salariés suédois déclarent avoir le sentiment d'être ‘de plus en plus sollicités par leur travail en dehors de leurs horaires professionnels' (52% en moyenne sur notre panel de pays) ou d'être ‘amenés à régler des problèmes personnels pendant leurs heures de travail' (moyenne : 42%). De même, dans leur grande majorité, ils estiment que leur entreprise ‘prête suffisamment d'attention à l'impact de leur vie professionnelle sur leur vie privée'.
On l'a vu brièvement, les salariés suédois sont aussi ceux qui se déclarent les plus heureux dans leur travail . Bonheur au travail rimerait-il donc avec cloisonnement entre vie privée et vie professionnelle ? Sans doute pour partie, comme on le verra par la suite avec l'analyse du modèle allemand, voire l'exemple de la Belgique – on peut également relever que c'est auprès des salariés suédois que l'on trouve le pourcentage le plus élevé de salariés ‘satisfaits' de l'ambiance de travail.
Il existe entre tous ces pays un autre point commun, la fidélité à l'entreprise : près de 70% des salariés suédois déclarent n'avoir ‘jamais songé à quitter leur entreprise'. Dés lors il est tentant, à l'instar de certaines approches anglo-saxonnes 5, d'identifier une relation de cause à effet entre respect de la vie privée, bonheur au travail et fidélité à l'entreprise.
Mais en revanche, et cela va à l'encontre du ‘modèle' proposé par certains cabinets anglo-saxons, en Suède, cette équation ne semble pas rimer avec ‘accomplissement' ou ‘implication' dans le travail . En matière d'implication, le salarié suédois est dans la moyenne basse européenne, largement distancié par l'Allemagne et la Belgique. De même, lorsque l'on aborde l'accomplissement dans le travail, la Suède a le score le plus faible de notre panel de pays – plus d'un quart des salariés déclarent même ne ‘jamais' s'accomplir dans leur travail.
Est-on alors face à un modèle en crise ? Ou plutôt dans un équilibre savamment entretenu et accepté par les entreprises, à l'opposé du modèle français du salarié ‘hyper productiviste' ?
Le modèle allemand partage quelques composantes clé du système suédois. Un bon équilibre vie privée vie professionnelle, une fidélité à l'entreprise à toute épreuve (pour l'instant tout du moins…) : à peine 18% des salariés allemands pensent ‘souvent qu'ils aimeraient faire un autre travail', 71% déclarent n'avoir ‘jamais songé à quitter leur entreprise'. Ce sont aussi ces mêmes salariés qui mettent le plus en avant la ‘sécurité' comme qualificatif décrivant le mieux le travail à leurs yeux.
Cependant, à la différence de l'exemple suédois, la fidélité va de pair avec l'implication : les salariés allemands sont, dans cette enquête, ceux qui se déclarent, avec les Belges les plus impliqués dans leur travail – mais aussi les plus satisfaits de leur rémunération, du contenu de leur travail et des relations avec leur hiérarchie.
Implication contre sécurité, à défaut de bonheur 6, telle semble être l'équation allemande . La conjoncture économique pousse toutefois à s'interroger sur la pérennité de cet équilibre 7, même si la régulation consensuelle de la société reste visiblement plus que jamais d'actualité.
Face à ces deux types ‘nordiques', l'Angleterre fait figure de contre modèle. Plaisir au travail ? Les résultats britanniques se situent plutôt dans la moyenne basse . A la question, ‘qu'est ce qu'évoque le travail pour vous ?', près de 40% des salariés anglais citent la ‘routine'. Implication dans le travail ? La réponse est très partagée, 30% ayant le sentiment de s'impliquer ‘suffisamment' et 12% ‘peu ou pas du tout' ! Attention cependant aux conclusions trop rapides, un salarié britannique sur deux déclarant s'impliquer ‘plus qu'avant' - record européen.
Sur le fond, ce qui se dessine à l'examen des résultats anglais, est un système dans lequel la valeur travail est faible et représente un investissement individuel qui doit être maximisé : la majorité des salariés interrogés, 55% au lieu d'un tiers à peine en Allemagne ou en Suède, déclarent ainsi songer à quitter leur entreprise et ‘examinent avec attention les offres qui se présentent ou ont déjà planifié leur départ'. Conséquence logique dans un environnement économique très dynamique et un marché du travail privilégiant la flexibilité et la fluidité ? On est loin en tout cas de la fidélité allemande ou suédoise.
Autre illustration de ce phénomène, les salariés anglais sont parmi les plus ‘satisfaits' de leur environnement de travail, des relations avec leur hiérarchie, des possibilités de formation ; mais ce sont aussi eux qui nourrissent les attentes les plus fortes dans ces domaines …sans parler de la rémunération qui est citée comme ayant une influence ‘essentielle ou très importante' sur leur implication par 83% des salariés anglais, soit pratiquement 20 points de plus que la moyenne de notre panel.
Des salariés ‘satisfaits', qui ‘s'accomplissent dans le travail', mais qui sont attentifs, prêts à saisir toutes les opportunités existantes sur le marché ; tel est le portrait moyen du salarié britannique.
Le salarié français apparaît dans ces conditions au carrefour de tous ces profils. Certains y verront le carrefour de toutes les contradictions si souvent énoncées à propos de la France 8 ; d'autres, la recherche d'un équilibre ambitieux – impossible ?
Premier signe distinctif, à la différence des modèles nordiques, l'imbrication entre vie privée et vie professionnelle est on ne peut plus prégnante : 60% des salariés français se disent ‘de plus en plus sollicités par leur travail en dehors de leurs horaires professionnels', soit 12 points de plus que la moyenne de notre panel européen - ils sont aussi ceux qui se déclarent les plus ‘amenés à régler des problèmes personnels pendant leurs heures de travail'.
Doit-on y voir la conséquence inévitable de l'application des 35 heures, sachant que par ailleurs le salarié français est un des plus productifs en Europe ? Sans doute, à la réserve près, que ce 60% est partagé par les Espagnols et les Italiens. Est-on alors plutôt face à un prisme ‘latin' ? Il est difficile de trancher, d'autant que les deux interprétations ne sont pas incompatibles. Mais à l'évidence, cette profonde imbrication de la vie privée et de la vie professionnelle est une donnée clé pour comprendre le ‘modèle' français – et devrait sans doute nous amener à analyser la question des ‘horaires de travail' sous un autre angle ou tout du moins avec une lecture moins restrictive qu'aujourd'hui.
Autre dimension à souligner, le salarié français est celui qui met le plus avant le ‘plaisir' lorsqu'il évoque le sens du travail , à la différence des Allemands qui parlent plus volontiers de ‘sécurité' ou des Anglais qui citent en majorité la ‘routine'. On tient ici une autre clé de lecture fondamentale du salarié français : la charge affective qui est associée au travail. Dans un registre proche, 42% de notre échantillon pensent ‘souvent qu'ils s'accomplissent dans le travail' à comparer avec les 30% obtenus en moyenne dans cette enquête. Tout cela tend à décrire une relation que l'on qualifierait volontiers, en forçant un peu le trait, d'hédoniste et de fusionnelle vis-à-vis de son environnement professionnel – c'est également en France que l'on constate parmi les niveaux les plus élevés de satisfaction à l'égard de l'ambiance de travail 9.
Est-ce là l'explication du niveau paradoxalement élevé de ‘frustration professionnelle' qui transparaît à l'examen de quelques chiffres ? Lorsque l'on combine dans un même indicateur, niveau d'insatisfaction et importance relative des différentes composantes de la situation professionnelle, on obtient un des scores les plus importants du panel (avec la Hongrie et l'Espagne) : d'un côté, la plupart de ces composantes sont volontiers jugées plus essentielles pour la motivation que la moyenne européenne, alors qu'en parallèle, le niveau d'insatisfaction fait partie des plus élevées, notamment sur la rémunération et les perspectives d'évolution. A cet égard, il faut ajouter que c'est aussi en France que l'on trouve l'une des proportions les plus massives de salariés évoquant ‘avoir souvent envie de faire un autre travail' ou de ‘quitter leur entreprise'.
Or, face à ces attentes, force est de constater que les obstacles sont multiples . En matière de rémunération , la politique de ‘modération salariale' est une constante depuis plusieurs années ; pour ce qui de l'évolution professionnelle , on mesure régulièrement dans les différentes enquêtes le faible potentiel de mobilité géographique des salariés français. A cela s'ajoutent une croissance économique atone, le taux de chômage qui en découle et les rigidités du marché du travail. D'où une aspiration et des attentes massives à l'égard du ‘développement professionnel', point faible désormais traditionnel dans la plupart des enquêtes de satisfaction conduites dans les entreprises françaises, et déjà repéré lors de la précédente édition du Baromètre Accor Services 10.
Au final, la comparaison avec les résultats des autres pays souligne les antagonismes du ‘modèle' français . Ainsi le salarié français partage avec son homologue britannique, une réelle appétence pour la mobilité ou l'évolution professionnelle , à la différence des allemands par exemple. Pourtant seul le salarié britannique peut profiter d'un marché du travail réellement dynamique. Dés lors, dans un environnement contraint , le salarié français semble nourrir un sentiment de frustration d'autant plus fort que sa relation au travail est nettement plus affective que ses voisins et que par ailleurs, la frontière vie privée/vie professionnelle, à l'évidence source d'équilibre pour les ‘nordiques', tend à s'effacer .
Pour éclairer le propos, on peut faire une comparaison avec les évolutions perçues chez le consommateur : on évoque de plus en plus un consommateur infidèle mais sans culpabilité face à une offre démultipliée, produit d'une société ‘sans mercis' 11. Cette définition s'applique aussi au salarié français, à une nuance près, mais fondamentale : tout comme le consommateur, le salarié français est bien infidèle mais seulement dans sa tête, car dans les faits il est très largement contraint d'être fidèle à son entreprise 12. N'y a-t-il pas dans cet antagonisme une autre explication de la frustration actuelle des salariés ? On peut remarquer qu'en seulement un an, le pourcentage de salariés français se déclarant ‘souvent' heureux a baissé de 9 points.
Comparativement aux quatre profils types qu'incarnent les salariés suédois, allemands, anglais et français, les salariés des autres pays couverts par cette enquête relèvent plus de profils mixtes : ainsi, les salariés belges partagent « fierté » et « bonheur » avec la Suède et « stabilité » avec l'Allemagne, mais aussi le niveau le plus élevé de satisfaction sur bon nombre de composantes de la situation professionnelle – la rémunération notamment ; les Italiens associent l'implication et la recherche de sécurité des Allemands avec la frustration et l'envie de changer des Français ; les Espagnols quant à eux allient la mobilité et le pragmatisme des Britanniques à l'insatisfaction des Français.
Enfin les salariés hongrois paraissent encore éloignés des problématiques ‘européennes' tant ils sont décalés sur bon nombre de questions, et notamment en premier lieu celle du bien être au travail, dont on rappellera qu'il constitue le point commun de la grande majorité des autres salariés européens interviewés dans cette enquête. Pour preuve de ce décalage, on peut relever que pour plus de la moitié des salariés hongrois le travail s'apparente à une ‘routine' ou une ‘contrainte' et que sur la plupart des composantes de la situation professionnelle, leur niveau de ‘satisfaction' est en moyenne de 5 à 10 points plus bas que la moyenne des pays couverts dans cette enquête.
On a cherché à compléter ce panorama par quelques questions ayant trait au rôle dévolu à l'entreprise par les salariés. Sur ce point, la fracture est nette entre d'un côté les trois pays ‘latins', France, Espagne et dans une moindre mesure, Italie 13 au sein desquels les attentes des salariés à l'égard de l'entreprise sont fortes, voire dépassent le cadre traditionnel de son champ d'intervention, et les autres pays d'inspiration plus anglo-saxonne . On constate en effet que les salariés ‘latins' déclarent plus volontiers que la moyenne, attendre une ‘intervention prioritaire' de leur entreprise dans des domaines tels que l'aide à la formation, l'accès aux soins de santé, l'épargne salariale/retraite, la restauration lors de la pause déjeuner ou encore l'aide aux transports…
Des nuances existent d'un pays à l'autre traduisant des réalités nationales différentes, mais l'élément clé est bien cette légitimité d'un rôle élargi de l'entreprise dans le monde latin à l'opposé du monde anglo-saxon. Doit-on y voir la marque d'un capitalisme plus marqué historiquement par l'intervention de l'Etat – et qui par ricochet, en ces temps de crise de l'Etat providence, légitimerait aujourd'hui une intervention élargie de l'entreprise ? Plus certainement, on aura constaté que c'est dans ces pays que la frontière entre vie privée et vie professionnelle est la plus perméable et que les niveaux de ‘frustration' à l'égard de la situation professionnelle sont parmi les plus importants.
Au final, que peut-on retenir de ce panorama notamment du point de vue des entreprises ? Que peut-on dire des enjeux auxquels elles vont devoir répondre ?
Pour les entreprises allemandes, belges ou suédoises, l'enjeu clé réside semble-t-il dans leur capacité à préserver un ‘équilibre' finalement très apprécié des salariés, qui garantit leur fidélité et entretient une vision très ‘sécurisante' du travail . Dans un contexte économique plus difficile, on pense ici surtout à l'Allemagne : quelles sont les marges de manœuvre dont disposent les entreprises pour préserver cet équilibre ? Leur capacité de dialogue avec les salariés et de négociation avec leurs représentants constitue sans doute un avantage indéniable.
Le ‘modèle' français interpelle quant à la capacité de ses entreprises à répondre aux aspirations d'évolution et de développement de leurs salariés, dans un environnement extérieur peu porteur de ce point de vue . L'enjeu est de taille, tant les attentes sont fortes à l'égard d'une entreprise plus proactive face à ses salariés, comme on a pu le voir y compris sur des éléments plus périphériques.
D'une certaine façon, la situation française n'est pas très éloignée de la situation anglaise. Car il est évident que le profil du salarié anglais appelle une vigilance toute particulière de l'entreprise et une capacité réelle à maximiser son ‘offre' (package) pour conserver ou attirer ses ‘ressources humaines' – jamais autant le terme ‘ressource' ne semble avoir de sens que vis-à-vis du salarié britannique.
D'où la tentation d'une approche très ‘marketing' des ressources humaines, que l'on voit surgir ailleurs en Europe et notamment en France. Mais la réponse réside-t-elle simplement dans le packaging et le marketing d'une politique de ressources humaines ? L'exemple du monde de la consommation devrait nous rendre prudent, à l'heure où de plus en plus d'observateurs parlent ouvertement d'une crise du marketing, d'un consommateur de plus en plus imperméable à la publicité et aux offres soigneusement élaborées pour rencontrer ses besoins.
Une approche fondée sur une prise en compte des attentes et des besoins de chaque salarié (et de ses caractéristiques ‘culturelles'), favorisant un ‘équilibre' basé cette fois sur un développement individuel du salarié et non plus sur un sentiment de sécurité à long terme aléatoire, telle semble être la perspective la plus prometteuse à long terme.
1. Ces deux options ayant été défendues avec un même allant ; cf. par exemple le sondage CSA/ Enjeux les Echos juillet 2003
2. Cf. les résultats et l'analyse du Baromètre Accor Services « Bien être et implication des salariés au travail » 2004 disponibles sur le site Ipsos.fr
3. Enquête réalisée entre le 6 septembre et le 11 octobre 2005 auprès d'échantillons représentatifs de salariés en Europe âgés de 18 ans et plus (hors artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs / exploitants). Au total, 10 288 personnes ont été interrogées.
4. Attention toutefois aux évolutions futures de cet indicateur : en un an, le pourcentage de salariés français se déclarant ‘souvent' heureux a baissé de 9 points (49 à 40%).
5. Modèle qui sous-tend notamment le palmarès établi par l'institut américain ‘Great Place to Work'
6. Les Allemands font partie des salariés les moins ‘souvent heureux'
7. Voir les annonces récentes de réductions massives des effectifs chez Volkswagen notamment
8. Parmi les exemples récents, Jacques Julliard « le Malheur Français », Flammarion 2005
9. 76% comme en Belgique et quasiment au même niveau que la Suède (79%)
10. « L'enseignement clé réside donc dans cette demande accrue de prise en compte des besoins individuels. Est-ce le seul fruit d'un changement des mentalités ? Assiste-t-on à la duplication dans l'univers de l'entreprise des tendances que l'on perçoit dans la consommation qui obéit de plus en plus à la satisfaction de besoins individuels de plus en plus pointus ? » Baromètre Accor Services Bien être et Implication des salariés au travail, juillet 2004
11. « France 2005, société sans mercis » Ipsos éditions, 2005
12. … surtout si celle-ci est de grande taille et à la réserve près de quelques secteurs particulièrement porteurs (services informatiques).
13. A ces pays latins, se greffe la Hongrie mais pour des raisons ayant sans doute plus à voir avec le développement même du pays.