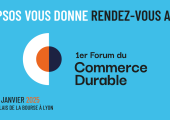Biotechnologie : les Français décodent
Beaucoup en ont entendu parler, très peu savent de quoi il en retourne : la biotechnologie fascine l'opinion, attire, inquiète… sauf quand on l’explique. La double enquête qualitative et quantitative Ipsos/AMGEN, menée auprès du grand public et de patients soignés par des traitements issus de la biotechnologie, fait le point sur les ignorances, les amalgames, les idées reçues ; elle met en évidence le manque comme le besoin d'informations, sur une science méconnue dans son principe et ses applications.
![]() Les évocations suscitées par la biotechnologie doivent plus à l'imaginaire qu'à une connaissance pratique et concrète. Les deux tiers des Français ont entendu parler de biotechnologie, mais la moitié d'entre eux ne sait pas ce que c'est. Dans un cas sur deux, on la confond avec l'écologie ; plus rarement, les Français l'identifient à la phytothérapie, l'imagerie médicale, la bionique ou la biométrie. Plus d'une personne sur trois pense que la biotechnologie est le nom scientifique de l'agriculture ou de l'alimentation biologique. Pour les interviewés, la biotechnologie est partout, elle "n'a pas de frontières", "elle englobe tout ce qui est vivant". Les connaissances (les trois quarts des interviewés savent que la biotechnologie permet de procéder à des transformations génétiques sur les végétaux) se mêlent aux visons les plus fantasmatiques (58% des sondés pensent qu'on l'utilise actuellement dans la procréation).
Les évocations suscitées par la biotechnologie doivent plus à l'imaginaire qu'à une connaissance pratique et concrète. Les deux tiers des Français ont entendu parler de biotechnologie, mais la moitié d'entre eux ne sait pas ce que c'est. Dans un cas sur deux, on la confond avec l'écologie ; plus rarement, les Français l'identifient à la phytothérapie, l'imagerie médicale, la bionique ou la biométrie. Plus d'une personne sur trois pense que la biotechnologie est le nom scientifique de l'agriculture ou de l'alimentation biologique. Pour les interviewés, la biotechnologie est partout, elle "n'a pas de frontières", "elle englobe tout ce qui est vivant". Les connaissances (les trois quarts des interviewés savent que la biotechnologie permet de procéder à des transformations génétiques sur les végétaux) se mêlent aux visons les plus fantasmatiques (58% des sondés pensent qu'on l'utilise actuellement dans la procréation).
Une acceptation des risques qui croît avec la perception de l'utilité des recherches
Peut-être parce que les Français ont une idée assez vague de ce qu'elle englobe, la biotechnologie fascine et inquiète, comme en témoignent les avis recueillis pour chaque grand secteur d'application. Pourtant, il suffit qu'elle leur soit expliquée par des chercheurs d'Amgen qui se sont prêtés à un jeu de questions / réponses avec les participants, pour que la plupart reconnaissent l'utilité de la biotechnologie dans le diagnostic et la thérapie génique et dans "la mise en place de traitements et de vaccins". Cette reconnaissance de l'utilité des recherches prévaut sur la perception des risques, pourtant jugés par une majorité comme très importants. A l'inverse en effet, les Français sont d'autant moins enclins à accepter le caractère risqué et moralement condamnable des recherches dont ils n'identifient pas les contreparties évidentes : la "modification génétique des plantes pour changer les qualités nutritives, gustatives, ou de conservation des fruits et légumes" réunit une majorité de défiants et seulement 29% des interviewés pensent que ces modifications sont utiles. Les OGM apparaissent aux Français encore plus moralement condamnables que la thérapie génique. Ce décalage est illustré par les espoirs investis dans ces recherche : on compte trois fois plus de Français à penser qu'à l'horizon de dix ans, la biotechnologie aura permis de guérir de nouvelles maladies (88%) qu'à penser qu'elle permettra de réduire la famine (29%) ou de réduire la pollution de l'environnement (38%).
Dans la même lignée, pour un peu plus d'une personne sur deux, on aura, d'ici dix ans "constitué une réserve de tissus organiques utiles aux greffes grâce au clonage". A l'espoir de rémission de maladies, deux personnes sur trois opposent également la création de nouvelles affections. Malgré tout, les interviewés s'accordent sur la nécessité de poursuivre les recherches : l'idée qu'il "faut continuer, aller plus loin, que les progrès potentiels apparaissent vraiment importants" prend largement le pas sur le souhait "d'arrêter là, de ne pas aller trop loin, car cela comporte trop de risques" (60% contre 33% de citations).
Quand la connaissance avance, la peur recule
On constate surtout que l'encouragement à poursuivre la recherche croît avec la connaissance effective de la biotechnologie et de ses applications. "La peur est créée par la méconnaissance", comme le souligne l'un des participants aux réunions de groupe. "Le problème, c'est ce qui est le plus médiatisé : les poules sans plumes, le clonage, …" ; "on fait peur en faisant du sensationnel, mais on ne rassure pas les gens sur des choses simples comme les greffes de tissu ou autre" ; " dire que l'insuline est issue de la biotechnologie, ça recadre le débat ". Les explications fournies aux participants de ces groupes par les chercheurs invités par Ipsos ont plus que rassuré, véritablement inversé les préjugés : " Avant que le chercheur arrive, on était tous négatifs, critiques. J'ai revu mon jugement". Ce revirement est essentiellement attribuable à la prise de conscience de la simplicité du " principe " : " soigner le corps avec le corps " selon l'expression des participants et surtout des applications thérapeutiques actuelles de la biotechnologie dans le traitement de maladies comme le cancer, l'insuffisance rénale ou le diabète.
Le grand-public comme les patients soignés par des traitements issus de la biotechnologie déplorent ainsi le manque d'information : "Au début, on doit s'injecter un truc dans les veines, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ?" - "J'ai dit voyons voir le poison qu'on va m'injecter ; alors qu'une protéine, c'est fabriqué par l'organisme. Si c'est naturel, c'est comme une greffe". Si la demande de pédagogie, de mise en perspective, ou d'information est importante pour une large majorité, elle apparaît cruciale chez des malades pour lesquels l'acceptation psychologique du traitement joue un rôle essentiel dans le vécu de la maladie.
Les Français attendent de tous les acteurs concernés de prendre la parole : des laboratoires car on a conscience de leur part importante dans la conduite des recherches -"il faut qu'ils prennent une part importante dans l'information"-, et des médecins, qui restent le relais principal d'information "il faut que les médecins eux-mêmes sachent ce qu'ils prescrivent". On souligne encore le rôle à jouer par la sphère politique. L'enquête qualitative montre combien la catastrophe de Tchernobyl, les affaires de vache folle, sang contaminé et hormones de croissance ont lourdement ébranlé la confiance à l'égard des systèmes institutionnels, et créé le besoin de procéder par soi-même à l'évaluation des risques.
Conscients du décalage qu'il existe entre leurs connaissances sur le sujet et les enjeux débattus sur la place publique, les Français sont demandeurs d'une remise à niveau : les participants rencontrés dans les groupes soulignent, après explications, que les débats sur la biotechnologie devraient moins concerner les expériences du gynécologue italien Antinori que la nécessité de soutenir la recherche sur un secteur qui représente déjà un médicament sur deux mis chaque année sur le marché. La démarche pédagogique s'impose à présent comme témoignage d'une transparence, qui, faute d'être utilisée par le grand public, indique qu'on ne leur cache pas les véritables enjeux.
cliquez sur l'image pour ouvrir l'étude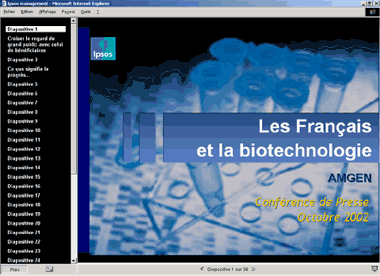
Fiche technique :
Enquête réalisée par IPSOS Opinion de juin à septembre 2002 selon la méthode suivante :
4 groupes de discussion ont été conduits en juin 2002, réunissant chacun une dizaine de participants diversifiés en sexe, âge et catégories socio-professionnelles à Paris, Lille et Lyon.
10 entretiens individuels ont été réalisés en face à face en juin et juillet 2002 avec des patients recevant des traitements issus de la biotechnologie (érythropoïétine, insulines, immunosuppresseurs, Interféron).
Le volet quantitatif a été réalisé par téléphone les 20 et 21 septembre 2002, auprès d'un échantillon national représentatif de la population française, composé de 1021 personnes âgées de 15 ans et plus. Les interviews ont été réalisées au domicile des personnes interrogées. L'échantillon est construit suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par régions et tailles d'agglomérations.