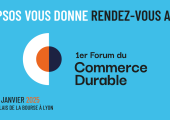En marge du sommet franco-allemand, la constitution de l'opinion publique européenne
Existe-t-il une opinion publique européenne ? Selon Pierre Giacometti, directeur général d'Ipsos Opinion, des préoccupations convergentes existent, notamment sur les problèmes économiques. Mais le chemin est encore long pour que naisse une opinion publique européenne homogène.
La difficile naissance d’une opinion publique communautaire
Existe-t-il une opinion publique européenne ? Selon Pierre Giacometti, directeur général d'Ipsos Opinion, des préoccupations convergentes existent, notamment sur les problèmes économiques. Mais le chemin est encore long pour que naisse une opinion publique européenne homogène.
L’existence de l'opinion sur la scène publique passe par la reconnaissance de son rôle comme acteur du jeu politique. Cette entrée en scène de l'opinion comme concurrente de l'intermédiation parlementaire s'est produite de façon très précoce outre-Atlantique et dans les années 60 en France, avec la révolution institutionnelle et médiatique de l'élection du président de la République au suffrage universel, ou plus récemment en Italie, quand l'irruption du scrutin uninominal majoritaire pour les élections municipales puis pour les élections législatives est venu interrompre des décennies de régime ultraparlementaire. Dès lors que l'opinion publique a besoin d'un théâtre, composé d'une scène, d'acteurs et d'intrigues, l'Europe ne peut, aujourd'hui, rivaliser avec les "théâtres nationaux", beaucoup plus anciens et mieux rodés. L’Europe de 1999 demeure pour les citoyens de l’Union une scène politique virtuelle, sans "figures" ni intrigues fortes.
Le contexte dans lequel se prépare le prochain scrutin européen du mois de juin peut à ce titre jouer le rôle de révélateur. Enfin les premières véritables élections européennes ? C’est l’une des questions de fond apparues ces derniers mois en France comme dans les autres pays de l’Union à propos de ce rendez-vous électoral. Il est vrai que les conditions historiques semblent réunies pour faire de cette échéance un premier épisode significatif de la manifestation d’une opinion publique européenne. Vingt ans après les premières élections au Parlement européen, le scrutin de 1999 se déroulera six mois après la création de l’euro, trois mois après un événement politique "européen" - la démission de la Commission -, et quelques semaines après le déclenchement du premier conflit armé en Europe depuis la seconde guerre mondiale. Malgré ce contexte exceptionnel, force est de constater que le scrutin européen demeure toujours dépourvu de statut et d’identité propres. La campagne électorale reste très en retrait dans les médias européens. Elle suscite peu d'intérêts et d'attentes auprès des opinions nationales. Cette indifférence cohabite aujourd'hui avec un consensus d'opinions non dépourvu de conformisme sur les questions européennes. Contrairement à ce que l’on veut parfois faire dire aux chiffres de sondages qui décrivent des Européens très majoritairement "européistes", ceux-ci restent, dans leur majorité les spectateurs d’un processus aujourd’hui encore très éloigné de leurs préoccupations quotidiennes. Le "théâtre" du 13 juin, théoriquement celui de l’élection de députés "européens" sera d'abord un théâtre nationale. Une opinion publique européenne ne peut pas être seulement l'amalgame d'opinions nationales dont les attitudes et les préoccupations convergent. Si la condition suffisait, la préoccupation commune et massive des Européens depuis vingt ans pour la question du chômage aurait dû suffire. Il ne faut pour autant pas négliger l’importance des mouvements d’opinion observés ces dernières années en Europe, qui progressivement installent de la ressemblance entre citoyens et consommateurs européens. Ainsi les travaux comparatifs menés par Ipsos auprès des opinions européennes indique la récente et forte convergence des attitudes des consommateurs en matière de confiance économique. Il y a à peine trois ans, près de 30 points d'optimisme séparaient le pays le mieux placé de celui qui manifestait le plus de pessimisme sur l'évolution du niveau de vie ; aujourd'hui, l'écart n'est plus que de 15 points.
L’environnement économique des Européens s’unifie, leurs appréciations et leurs comportements deviennent plus homogènes et interdépendants comme le démontre également l’harmonie des opinions européennes dans le sens d’une adhésion partout majoritaire (y compris outre manche !) à l’Euro.
Au-delà du champ économique, l’Europe des opinions nationales gagne également en points de vue communs. Partout, la préoccupation pour les territoires de "sécurité" progresse : inquiétude pour l’insécurité urbaine, souci croissant pour la préservation de l’environnement, sensibilité unanime au thème de la sécurité sanitaire, angoisses face aux périls sociaux illustrée par la montée de l’exclusion sociale, préoccupation pour la sécurité collective de l’Europe enfin, avec la guerre en Yougoslavie. Cependant il n’y aura pas d’opinion européenne sans union politique. Plus encore, il n’y aura pas d’opinion européenne sans que les peuples n'interviennent dans le choix d’un exécutif. L’opinion européenne a besoin de ses propres figures choisies par les citoyens. Car elle doit aussi faire face à des concurrences. La première est celle d’une société occidentale de plus en plus mondialisée, notamment en matière d’information et de communication. Après les premières images télévisées diffusées simultanément par toutes les télévisions, on a enregistré dans tous les pays occidentaux la progression du soutien à l’intervention de L’OTAN en Yougoslavie. Ce phénomène ne peut cependant être considéré comme l’émergence réelle d’une opinion européenne singulière, mais plutôt d'une opinion "internationale" ou "occidentale". Le second niveau de concurrence est opposé. Il s’illustre dans la consolidation, partout en Europe, des régionalismes, des micro-nationalismes, qui peuvent, on le voit, conduire à la violence. Il y a une opinion publique basque, écossaise ou corse. La vivacité des réflexes identitaires, la progression en Europe du sentiment d’attachement à ce qui est proche ("ma région", "ma langue", "ma culture", "ma religion"), constitue également, d’une certaine manière, un frein à la constitution de cette opinion européenne. Mais ces poussées régionalistes sont aussi les signes forts d’un désarroi des citoyens confrontés à des systèmes politiques nationaux souvent perçus comme impuissants et à un pouvoir politique européen trop peu visible.
Face à la mondialisation des opinions et aux réactions souverainistes que ce processus génère au niveau des Etats et des régions d’Europe, l’opinion européenne a besoin comme cela s’est produit dans les pays qui la composent, d’entrer dans le champ de la délibération politique.
Article paru dans le journal Le Monde du 28 mai 1999.