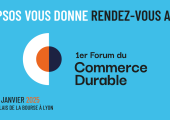La mondialisation ne gomme pas les spécificités régionales
La vaste étude internationale réalisée par Ipsos dans 20 pays montre que, six mois après le choc des attentats aux Etats-Unis, la solidarité internationale n'a pas débouché sur un rapprochement des opinions et des comportements. Selon Thomas Riehle, Président d'Ipsos-Reid US Public Affairs, les six mois de guerre en Afghanistan auraient même renforcé les divergences entre l'Amérique et le reste du monde
Les attentats du 11 septembre et les six mois de guerre en Afghanistan n'ont pas effacé les divergences d'opinion entre Américains et le reste du monde.
En témoigne déjà la hiérarchie établie par les interviewés des "questions à traiter en priorité par le gouvernement". Les Américains placent en tête la lutte contre le terrorisme (28%) et les affaires internationales, quand les Européens pensent avant tout social et économie (27% pour chaque thème). En Europe, la lutte contre le terrorisme et les questions internationales ne constituent une priorité que pour 13% des personnes interrogées. La zone Asie-Pacifique est aujourd'hui surtout préoccupée par les questions économiques (46% de citations), tandis qu'en Amérique du Sud, économie (46%) et social (42%) prédominent.
Il faut dire que, selon une étude récente de l'institut Gallup, près de neuf Américains sur dix (87%) considèrent toujours que les attentats du 11 septembre constituent l'événement le plus tragique de leur vie. Cet événement a changé leur vision du monde, marqué pour eux une véritable rupture dans la civilisation, et l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Début février, une enquête conduite par ce même institut mettait ainsi en évidence de profonds changements dans la perception des pays étrangers : la Russie fait aujourd'hui partie des sept pays les plus populaires aux yeux des Américains ; la sympathie pour les pays européens et asiatiques a sensiblement progressé ; l'opinion sur Cuba est de plus en plus positive, comme celle sur la Libye, qui n'est plus considérée comme le berceau du terrorisme. A contrario, la popularité des autres pays musulmans, des Philippines et de la Corée du Nord, a spectaculairement chuté en un an. Si les anciens ennemis communistes sont de plus en plus souvent considérés comme des amis, les pays musulmans sont regardés avec une suspicion croissante.
Autre source de clivage international, l'appréciation de l'influence des Etats-Unis sur l'économie mondiale et les droits de l'homme. Les Américains jugent bien évidemment que leur pays a joué un rôle positif sur ces deux sujets dans la dernière décennie ; les réponses enregistrées sur l'ensemble des pays du G7 vont encore dans le même sens : un peu plus d'une personne sur deux pense que les Etats-Unis ont une influence positive sur l'économie mondiale et le respect des droits de l'homme, contre environ une sur cinq d'avis contraire. En revanche, si l'on ne retient que l'avis des Européens, le soutien est loin d'être aussi fort, particulièrement sur la question des droits de l'homme. La majorité des Turques, des Chinois et des Sud-Américains considèrent comme négative l'influence des Etats-Unis sur le respect des droits de l'homme.
En marge des divergences d'opinions, on relève également des différences dans la façon de vivre, de se comporter, d'envisager l'avenir, entre Américains et reste du monde. En particulier, l'individualisme est, à n'en pas douter, nettement plus développé aux Etats-Unis qu'ailleurs. Le besoin qu'éprouve chaque Américain de ne compter que sur lui-même, et ni sur sa famille ni sur les aides publiques, initie une sensation toujours plus forte de risque. La facilité de mobilité sociale, ascendante mais aussi descendante, renforce, dans les classes moyennes et supérieures, l'inquiétude et le sentiment de vulnérabilité quant au long terme. La compétition, le "struggle for life", qui accompagne les Américains dès le plus jeune âge, intensifie le rythme de vie et est source de stress – ce qui n'est pas des plus attrayants pour le reste du monde. Des 20 pays de l'enquête, c'est aux Etats-Unis que l'on est le plus inquiet sur sa capacité à assumer financièrement la dernière partie de sa vie. Dans les pays plus pauvres, les gens se soucient nettement moins de ce qu'ils feront "quand ils seront trop vieux pour travailler". La manière dont les gens se préparent à relever les défis financiers futurs est symptomatique. Sur la question des retraites, les Américains et les personnes vivants dans la zone Asie-Pacifique comptent surtout sur leurs propres économies. Les Européens comptent sur un mélange entre pension gouvernementale, caisses complémentaires et économies personnelles. En Amérique du Sud, on se repose surtout sur la solidarité familiale.
Au niveau microéconomique, les consommateurs américains étaient déjà d'humeur morose avant les attentats. C'est aujourd'hui toujours le cas, et rien ne laisse supposer que les choses vont s'améliorer rapidement. Une minorité d'Américains envisagent de réduire leurs dépenses (15%), la même proportion pensent les augmenter ; mais les deux tiers des Américains interrogées ont l'intention de les maintenir à leur niveau habituel. Dans les pays du G7, et plus spécifiquement en Europe, les intentions de consommations sont en comparaison plus optimistes pour les six prochains mois. En revanche, si le moral des consommateurs de la zone Asie-Pacifique ressemble à celui des Américains – une proportion légèrement supérieure envisageant de réduire leurs dépenses, la situation peut sembler dramatique en Amérique Latine – en Argentine en particulier, où les consommateurs, bien que partant de très bas, déclarent n'avoir d'autres choix que de réduire encore leurs dépenses. C'est pourtant dans le domaine de la consommation qu'on trouve une opinion mondiale plus consensuelle. Certes, la répartition des avis sur le vieux débat entre libre-échange et protectionnisme, relancé par les polémiques accompagnant les restrictions imposées récemment par les Etats-Unis sur l'importation de certains produits, ne permet pas de trancher. Sur plus de 10 000 interviews, 45% des sondés sont favorables au libre échange contre 46% au protectionnisme. Comme l'on pouvait s'y attendre, les jeunes, les plus éduqués, les milieux aisés sont plutôt "libre-échangistes". Les pays développés du Sud-Est asiatique également, depuis le boom économique des années 80. Mais ce débat semble aujourd'hui dépassé par une nouvelle revendication de consommation. La moitié des personnes interrogées de par le monde estime comme une bonne chose la disponibilité et la possibilité d'acheter partout les produits des grandes multinationales, quand 17% pensent que cette disponibilité est une mauvaise chose. Les deux tiers des Chinois et des Japonais soutiennent ainsi la "liberté de consommer", comme les trois-cinquièmes des Portugais et des Sud-Africains, et la majorité des Américains, Allemands, Britanniques ou Thaïlandais. L'affrontement entre partisans et opposants de la mondialisation libérale, qui a débuté à Seattle en décembre 1999 pendant la conférence de l'Organisation Mondiale du Commerce, oppose en fait deux élites. D'un côté, "l'establishment" (grandes entreprises, ministères du commerce et des affaires étrangères, juristes de la propriété intellectuelle, consultants), de l'autre "l'anti-establishment" (étudiants, ONG, syndicats). Quelle que soit leur nationalité, la plupart des gens sont loin de chacun de ces deux groupes. Leur quotidien les éloigne des grands discours gouvernementaux, sans qu'ils aient le temps, la motivation ou la volonté de chercher une alternative à la mondialisation. Ils vivent dans un monde nettement plus pragmatique, se concentrant sur leur propre consommation, et veulent d'abord trouver les produits de grandes marques internationales dans leur magasin de quartier. Cette revendication consensuelle aux quatre coins du monde est évidemment incompatible avec un protectionnisme acerbe, et devrait jouer en faveur du développement du commerce international.
L’ensemble des résultats disponibles en format PDF (en anglais)
Fiche technique :
Enquête réalisée entre le 19 Novembre et le 17 Décembre 2001.
Echantillons aléatoires d'adultes de 18 ans et +.
La taille de l'échantillon dans chaque pays est de 500 individus, à l'exception des Etats-Unis (1000 individus).
Marge d'erreur pour chaque pays : +/- 4,5% (+/- 3,1% aux Etats-Unis).
Enquête réalisée par téléphone, sauf en Pologne, Argentine, Turquie (face à face)
Brésil, Chine, Colombie, Turquie, Mexique, Afrique du Sud : zones urbaines uniquement.