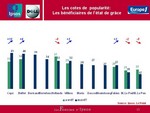Législatives : plus proches de la vague bleue de 2002 que du raz-de-marée de 93
L'état de grâce : décryptage et questions
Popularité
Les indicateurs de popularité pour les deux nouvelles têtes de l'exécutif ont fait un bon depuis l'élection du 6 mai. Pour Nicolas Sarkozy, on est passé d'un soutien autour des 50% en avril, au fameux "deux Français sur trois" aujourd'hui. Surtout, il bénéficie d'un socle de soutien "résolu" – les personnes très favorables à son action – proche de 20%, phénomène habituel pour Nicolas Sarkozy, mais pas pour un Président de la République. A l'inverse, l'opposition "résolue" s'atténue. Au final, le chef de l'Etat dispose d'une marge de manœuvre confortable, que n'avait pas son prédécesseur. Pour Jacques Chirac en 2002, l'hostilité résolue l'emportait sur le soutien.
Mais plus encore que Nicolas Sarkozy, le vrai bénéficiaire de l'état de grâce est François Fillon. Peu connu avant sa nomination, il est aujourd'hui largement soutenu. Ce n'était pas non plus le cas pour Jean-Pierre Raffarin, qui souffrait d'un déficit de notoriété même après son arrivée à Matignon.

Dans le détail, on observe de bons résultats en terme de popularité chez les jeunes, comme, mais c'était plus attendu, chez les plus de 60 ans. Une des caractéristiques de l'état de grâce est également le fort soutien des milieux populaires, ouvriers et employés ; l'épisode du yacht n'a pas laissé de traces. Les choses sont en revanche plus équilibrées chez les cadres supérieurs et les professions intermédiaires. Les mesures ventilées selon le niveau d'étude des Français confirment cette structure de popularité, avec un soutien important chez les personnes sans diplôme, ou qui n'ont pas fait d'études supérieures.

En termes de proximité partisane, on relève le soutien nettement majoritaire dans l'électorat de François Bayrou ; un tiers des sympathisants de gauche porte également un jugement favorable sur l'action de l'exécutif.
Nicolas Sarkozy et François Fillon ne sont pas les seuls bénéficiaires de l'état de grâce. Même si l'on n'enregistre pas le même niveau de soutien "résolu" que pour Nicolas Sarkozy, les popularités de Michèle Alliot-Marie (65%, son record) et d'Alain Juppé (46%) ont fait un bon de 17 points entre les mesures d'avril et de mai. La première place de Bernard Kouchner au palmarès des leaders politiques est également renforcée (70% de bonnes opinions, +9). A noter encore la progression de 7 points de Dominique Strauss-Kahn, grâce au soutien plus important des sympathisants de droite (popularité stable à gauche). A l'inverse, le baromètre Ipsos-Le Point témoigne d'une baisse de popularité de la famille Le Pen, et des difficultés de François Hollande, dont la chute de 5 points est la plus marquante de cette vague post élection présidentielle.
L'observation des résultats du baromètre par électorat montre que la plus forte progression de popularité chez les sympathisants UMP est celle de Bernard Kouchner, rapidement adopté (81% d'avis favorables, +23 points). Le Ministre des Affaires étrangères n'est devancée à droite que par Michèle Alliot-Marie, qui renforce dans son camp son leadership, derrière Nicolas Sarkozy. A noter également le retour en grâce d'Alain Juppé. A gauche, Ségolène Royal reste la préférée (84%), nettement au-dessus de ses rivaux. Bertrand Delanoë se rapproche néanmoins, à 76% de bonnes opinions (+7). Presque aussi populaire, François Bayrou est soutenu par les trois-quarts des proches du PS (74%, +4). Vu le contexte, la baisse de 3 points de Bernard Kouchner à gauche est limitée (toujours 70% d'avis favorables).
Invité à commenter ces mesures de popularité, Eric Dupin parle d'un certain classicisme. "L'état de grâce actuel fait penser à l'élection de François Mitterrand en 1981. En fait il existe après chaque élection, mais il se conjugue parfois avec l'idée d'une France coupée en deux. Alors même que la personnalité de Nicolas Sarkozy semblait prédisposer à cette analyse, alors même que le résultat électoral aurait pu faire émerger cette idée, personne n'en parle. Le charisme de Nicolas Sarkozy rayonne sur son gouvernement et au-delà. Sa manière de voir, de manœuvrer, est un succès."
Un parallèle avec le premier mandat de Tony Blair
Cet état de grâce peut-il durer ? Oui répond Pierre Giacometti, qui propose un parallèle avec le premier mandat de Tony Blair. "En général, la fin de l'état de grâce correspond à une rupture de confiance économique (cf. Mitterrand). Le point capital pour Nicolas Sarkozy dans les mois qui viennent est de redonner confiance aux Français. Les tendances proposées par le baromètre d'opinion réalisé par Ipsos depuis dix ans dans 5 pays européens (France, GB, Allemagne, Italie, Espagne) plaident en sa faveur. Ainsi, l'indicateur de confiance dans l'évolution du niveau de vie en France est en nette progression. L'indice est toujours négatif, mais on se rapproche de l'équilibre. L'enjeu pour le pouvoir est de renforcer cette dynamique, pour installer sa popularité. A titre de comparaison, la Grande-Bretagne a toujours maintenu un niveau de confiance supérieur à 20%.

Idem pour la confiance collective dans la situation économique et sociale du pays, où un effet de choc salutaire après la présidentielle nous ramène au niveau actuel de la Grande-Bretagne. L'évolution de la confiance gouvernementale est encore plus spectaculaire, avec un indice qui est passé de -41 pour le gouvernement Villepin en février 2007 à +26 aujourd'hui, soit un largement au-dessus des standards européens.
Nous avons bien là ce que l'on pourrait qualifier de "choc d'état de grâce". On retrouve les niveaux records dont bénéficiait Tony Blair à ses débuts, et pendant son premier mandat. A l'instar de ce que l'on a observé en Grande-Bretagne, ce climat de popularité peut durer.
Les élections législatives : une garantie, des inconnues
Intentions de vote 1er tour
Les mesures quotidiennes d'intentions de vote législatives Ipsos sont largement favorable à la droite, et anticipent un rapport de force proche de celui de 2002, très déséquilibré en termes de sièges à l'Assemblée Nationale en faveur de la majorité présidentielle. A 29% d'intentions de vote pour le PS, 35,5 pour la gauche dans son ensemble, c'est plus l'écart avec la droite (mesurée à 44%) que le niveau en lui même qui pose problème pour l'opposition. La gauche pâtit de l'effritement du Front National, revenu au niveau d'avant 1988 et son ascension.
Eric Dupin rappelle que c'est la première fois dans une campagne électorale qu'un camp part quasi-officiellement battu. "Faire appel au vote humanitaire est assez rare." Il y voit l'accentuation d'une dynamique défavorable à la gauche.
Reports de voix Présidentielle / Législatives
En termes de reports de voix, on constate une petite perte dans l'électorat de Ségolène Royal. Le plein n'est pas fait, ce qui contraste avec un soutien presque mécanique de l'électorat de Nicolas Sarkozy. Diversifié et hétérogène, l'électorat de François Bayrou se divise pour les législatives : en gros, la moitié reste fidèle au MoDem, l'autre moitié se répartit équitablement entre gauche et droite, comme dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Enfin si les deux tiers des électeurs de Jean-Marie Le Pen confirment une intention de vote Front National, la question de la mobilisation de cet électorat est posée.
Abstention
Le taux d'abstention constitue une inconnue importante du scrutin de dimanche prochain. Une certaine démobilisation est habituelle entre un 1er tour de Présidentielle et un premier tour de Législatives. Aujourd'hui Ipsos mesure une perte de 13 points, pour une participation plutôt supérieure à la moyenne, autour des 70%. La démobilisation n'est pas franchement plus forte à gauche qu'à droite.
Seconds tours
Sur la matrice centrale Gauche/Droite, le rapport de force est nettement favorable à la droite. Pour autant, l'historique du scrutin incite à la prudence. En 2002, l'écart final entre le candidat de droite et de gauche a été inférieur à 3 points dans 84 circonscriptions, entre 3 et 5 points dans 49 autres. Avec une incertitude susceptible de mobiliser l'électorat dans l'entre-deux-tours, le sort de ces 150 circonscriptions très disputées est une inconnue qui jouera sur l'ampleur de la victoire de la droite, et influencera beaucoup la lecture des résultats. La projection en siège propose un scenario de stabilité par rapport à 2002, plus qu'un raz-de-marée façon 1993. Ne serait-ce que parce que la vague bleue a déjà eu lieu en 2002, et que les 175 circonscriptions actuellement à gauche sont solides.
Avec l'argumentaire de campagne positif pour la droite, défensif pour la gauche, Eric Dupin croit tout de même en une abstention différentielle assez classique du camp perdant, la gauche, même si ce n'est pas mesuré aujourd'hui par les sondages. Il s'attarde par ailleurs sur le score du MoDem, qui sera intéressant à observer : "sans sortants, si le MoDem frôle la barre des 10%, il réussira une performance électorale qui révélera l'émergence d'une nouvelle force authentiquement centriste. Avec un électorat composite et un positionnement pas totalement affirmé, les 18,5% de François Bayrou étaient plus difficiles à analyser." Mais Eric Dupin poursuit son commentaire en rappelant que depuis 1968 on a toujours eu au moins quatre groupes à l'Assemblée Nationale, alors que cette année on n'en aura plus que trois, voire même deux si l'on considère que le Nouveau Centre est élu avec les voix de l'UMP. "Nous aurons en gros 2 groupes UMP et PS, avec des satellites. La marche vers le bipartisme franchit un pas supplémentaire, malgré l'émergence d'un "petit centre" dans l'opposition."
Le mode de scrutin
Si au final les urnes livraient comme résultat l'UMP dans sa fourchette haute et la gauche dans sa fourchette basse, la majorité écrasante dont bénéficierait la droite ne manquerait de poser la question du mode de scrutin. Or contrairement à ce que l'on entend parfois, ce dernier ne serait pas le seul responsable : le graphique ci-dessous témoigne qu'avec la même loi électorale, on a obtenu des rapports de forces beaucoup plus équilibrés. Par ailleurs, une question d'opinion posée en complément de la dernière vague d'intentions de vote montre que le débat n'est pas tranché. En fait sur cette question et depuis 20 ans, l'opinion gère plutôt ses intérêts, en témoigne le détail des résultats par famille politique.