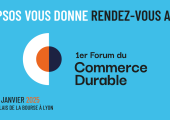Les actifs d’aujourd’hui s’inquiètent pour leur longue retraite de demain
Envieux du niveau actuel des retraites, les actifs craignent les conditions financières de leur future période d’inactivité qu’ils prévoient longue. Tout en préférant un système de financement mêlant répartition et capitalisation, ils se montrent plutôt favorables à une augmentation des cotisations.
Avant tout pessimistes : c’est ce qui frappe de prime abord à la lecture des résultats de l’enquête sur l’avenir du système de retraites, réalisée par Ipsos pour le magazine "L'ARGUS" auprès d’un échantillon représentatif de la population active. Une majorité d’entre eux (53%) considère ainsi que les retraités d’aujourd’hui sont financièrement plutôt favorisés, alors que près des trois quarts (72,%) ont le sentiment qu’eux-mêmes, après leur départ en retraite, seront financièrement plutôt défavorisés. Ce pessimisme se révèle plus largement partagé encore par les actifs les plus jeunes, les salariés du privé et les ouvriers.
Ce pessimisme trouve vraisemblablement une partie de son origine dans le décalage existant entre les montant des retraites prévus par les actifs et les montants minimums qu’ils jugeraient acceptables : 15% d’entre eux seulement prévoient une retraite d’un montant mensuel supérieur aux trois quarts de leur dernier salaire, alors que 45% considèrent cette même tranche de montant comme le minimum acceptable. Ce sont, en effet, bien plus les montants perçus après leur départ en retraite que le niveau de leurs cotisations actuelles aux régimes obligatoires qui semblent générer ce sentiment d’inquiétude : moins du quart des actifs (24 %) seulement jugent plutôt "pas acceptable" le montant de leurs cotisations aux régimes de retraite.
Au-delà de ce pessimisme, c’est la méconnaissance qui caractérise l’attitude des actifs à l’égard des retraites : seul un quart d’entre eux déclare connaître, même approximativement, le montant de leurs cotisations. Cette ignorance est fortement corrélée à l’âge et au niveau de revenu : plus les actifs avancent en âge et progressent en revenu, mieux ils connaissent le montant de leurs cotisations, ce qui semble assez compréhensible.
La perspective de reculer l’âge de départ en retraite ne semble pas avoir encore eu d’écho sur les actifs : quand on les interroge en effet sur l’âge auquel ils envisagent de prendre leur retraite, leurs réponses traduisent une volonté de départ plutôt précoce. L’âge moyen envisagé est de 58 ans et seuls 22 % d’entre eux se voient partir après 60 ans. Dans le même ordre d’idée, ils optent très majoritairement (pour les deux tiers) pour un départ progressif en retraite. Cette préférence est encore plus marquée chez les plus jeunes actifs (70 %).
L’inquiétude des actifs s’explique également par leurs comportements d’épargne : si 58 % d’entre eux déclarent mettre régulièrement de l’argent de côté ou faire des placements pour préparer leur retraite, pas moins de 42 % s’abstiennent de le faire. Au sein de la catégorie "d’actifs prévoyants" (les 58 % qui mettent de l’argent de côté), une majorité absolue (61%) déclare ne consacrer que 10% ou moins de 10 % de leurs revenus mensuels à la préparation de leur retraite. Pourtant, un majorité absolue de ces actifs prévoyants jugent ce montant de revenus consacrés à leur retraite (en moyenne 12%) plutôt pas suffisant.
Les types de placements privilégiés par ces actifs prévoyants pour préparer leur retraite sont, sans surprise, en premier lieu l’assurance-vie (pour 40% d’entre eux), suivie par le PEP (26%). Des produits tels que le PEA ou le PEE sont évoqués par une minorité dans cette catégorie de prévoyants.
Chez les "actifs imprévoyants" (les 42% qui ne mettent pas d’argent de côté), seule une minorité (45%) envisage de "devenir prévoyant" (en mettant régulièrement de l’argent de côté pour préparer leur retraite). La hiérarchie des placements envisagés par ces "actifs imprévoyants mais envisageant de le devenir" se révèle sensiblement différente de celle des "actifs prévoyants" : les biens immobiliers ou fonciers figurent en première place (avec 36% de citations), alors qu’ils occupaient la dernière place chez les prévoyants. L’assurance-vie se voit pour sa part reléguée en deuxième position.
L’actif français confronté à la perspective de sa retraite se caractérise encore par sa relative perplexité (ou son indécision). Interrogés sur les solutions destinées à assurer l’avenir du système de retraite, les actifs privilégient largement (59 % d’entre eux) un système mixte, où chacun peut compléter sa retraite de régimes obligatoires par son épargne personnelle, au détriment des deux systèmes "purs" fondés soit sur la répartition, soit sur la capitalisation. Cette préférence pour un système mixte varie d’ailleurs assez peu d’une catégorie d’actifs à l’autre : qu’ils exercent leur activité dans le secteur public ou dans le privé, qu’ils expriment une sympathie pour la gauche ou pour la droite, c’est toujours la mixité qui l’emporte.
Indécision également sur le système de complément de retraite envisagé : les actifs se révèlent très partagés entre un placement financier personnel et facultatif (27 %), un système d’épargne retraite facultatif pour leur entreprise et obligatoire pour les salariés (27%), un placement financier proposé par leur entreprise (24%) et un système d’épargne retraite obligatoire (19%). Partagés encore sur les solutions d’incitation fiscale accompagnant un éventuel système d’épargne retraite, 49 % des actifs privilégient une exonération d’impôt du complément de retraite, contre 47 % optant pour une déduction ou une réduction d’impôt au moment du versement.
Partagés enfin sur les solutions pour équilibrer financièrement les régimes de retraites obligatoires, aucune parmi celles proposées ne parvenant à recueillir une majorité absolue, même si l’augmentation du montant des cotisations semble être plus souvent privilégiée (34%) que la diminution du montant des retraites (10% seulement). L'allongement de la durée de cotisation ou encore le recul de l’âge de la retraite sont des modalités envisagées en priorité seulement par un actif sur cinq.
Au-delà de ces divergences entre les solutions à mettre en place, il semble que la voie la mieux acceptée, ou la moins "douloureuse", réside dans l’augmentation du montant des cotisations : près d’un actif sur deux juge le montant actuel de celles-ci plutôt acceptable contre moins du quart qui le considèrent comme pas acceptable. Si l’on ne prend en compte que la minorité connaissant, même approximativement, ce montant (c’est-à-dire ceux qui s’expriment en connaissance de cause), cette proportion d’ actifs "acceptant" le montant de leurs cotisations passe même à 60% (contre 36% qui ne le jugent pas acceptable). Le politique – et les partenaires sociaux - trouveront donc dans les résultats de cette enquête matière à réflexion pour dégager la voie d’un consensus sur ce délicat problème.
En revanche, leurs préférences s’affirment plus nettement dès lors qu’il s’agit de s’exprimer sur les modalités de perception de leurs retraites: une majorité absolue d’actifs (55%) préférerait disposer d’une rente à vie plutôt que d’un capital (10%), alors que le tiers restant opterait pour un mode mixte (alliant rente et capital). Cette préférence marquée pour la rente au détriment du capital se révèle d’ailleurs tout à fait rationnelle, ou à tout le moins cohérente avec leur espérance de vie exprimée, c’est-à-dire avec l’âge jusqu’auquel ils espèrent vivre. La moyenne de cette "espérance de vie exprimée" s’avère en effet élevée (83 ans) surtout comparée à l’âge moyen de retraite souhaité (58 ans). Les retraités du futur envisagent de vivre dans cet état pendant un quart de siècle.
Un consensus assez large (68%) se dégage également, sans surprise, autour du principe de participation des entreprises au financement du complément de retraite de leurs salariés : seuls 29% des actifs jugent cette participation pas normale, au motif qu’elle n’entre pas dans le rôle des entreprises et risque de pénaliser l’emploi. Ce sont d’ailleurs les plus jeunes qui sont les plus nombreux à partager ce sentiment d’une participation souhaitable des entreprises (74% des moins de 25 ans contre 63% des 45-59 ans).
Les actifs s’expriment enfin clairement sur la confiance qu’ils accordent aux différents acteurs pour gérer leur épargne-retraite : par ordre de priorité, ils font d’abord confiance à une banque (37 %), ensuite à leur caisse de retraite complémentaire (20 %), les partenaires sociaux occupant… la dernière place avec 5 % seulement de confiance. Signalons toutefois que plus les actifs avancent en âge, plus la confiance qu’ils accordent à leur caisse de retraite augmente : c’est le cas en particulier des 45-59 ans (ceux-la mêmes se préoccupant vraisemblablement le plus de leur retraite), qui sont plus nombreux à exprimer leur confiance à leur caisse (29 %) qu’à une banque (25 %).