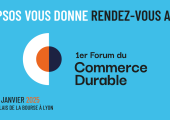Les jeunes sont pessimistes pour la société, mais optimistes pour eux-mêmes
Les paradoxes de la jeunesse française vus à travers Jeunes Attitudes : L’observatoire Ipsos Insight des 15-30 ans
En cette période agitée où les étudiants investissent la Sorbonne pour contester le CPE, prenons du recul sur leur situation et jugez par vous même …
Quand on les interroge sur l’avenir de la société française, et l’actualité récente en est la manifestation évidente, rien ne va plus : 71% se déclarent pessimistes et n’ont pas confiance dans l’évolution de la situation économique en France dans les années à venir. Un niveau de pessimisme supérieur à celui du reste de la population (67%). Et un sentiment qui se nourrit de leur perception de la période récente : 74% des 15-30 ans ont en effet le sentiment que les inégalités sociales en France ont fortement augmenté au cours des dernières années. …
Mais quand on les interroge sur leur avenir, la réponse des 15-30 ans en France est quasi unanime. 74% sont très ou plutôt confiants dans leur avenir personnel. Les vrais pessimistes ne sont qu’une poignée : 3% en effet des 15-30 ans ne croient pas du tout en leur avenir. D’ailleurs, ce n’est pas seulement le futur qui s’annonce rose pour eux mais également le présent puisque 81% se disent tout à fait ou plutôt satisfaits de leur vie jusqu’à maintenant.
Que se passe-t-il ? Il y a aujourd’hui en France un divorce entre leur futur tel que le perçoivent les jeunes pour eux mêmes et celui de la société. Situation paradoxale pour le moins : on peut donc être pleinement confiant dans ses propres capacités et, simultanément, ne pas croire dans celles de la société dans laquelle on vit.
C’est un des nouveaux paradoxes de notre société… Au sein des mêmes individus prévaut une sorte de dissociation qu’on pourrait résumer d’une formule : « pessimiste pour la société, optimiste pour soi-même ».
Peut-on vivre durablement dans la dissociation ? Le débat est ouvert. On peut penser d’un côté qu’émerge, dans la jeune génération, la conscience que la réussite passe d’abord par soi-même et qu’il faut désormais se prendre en main, ne pas trop attendre des autres, des institutions par exemple. Ainsi pourrait s’expliquer qu’en Europe ils sont nettement moins enclins à penser que la réussite dans la vie est une affaire de chance : seuls 27% des jeunes Français le pensent contre 42% des jeunes britanniques, 42% des jeunes Allemands ou 34% des jeunes Espagnols (source : Jeunes Attitudes Europe 2006). On peut aussi pointer du doigt la contradiction d’une société dans laquelle la jeune génération ne conçoit plus son avenir comme devant nécessairement être lié à celui de la société et de son économie. A l’évidence, les interprétations sont multiples.
Peut-être, tout simplement, que les jeunes regardent désormais vers l’extérieur ? On pourrait le penser en effet à travers une indication en particulier : seulement 28% ne se voient pas vivre à l’étranger. La plupart, même s’ils ne passeront pas nécessairement à l’acte, envisagent plutôt sereinement une éventuelle expatriation au cours de leur vie. Néanmoins, une ambivalence se retrouve aussi dans l’attitude des jeunes par rapport au monde extérieur. Si l’europessimisme n’est pas de mise, l’avenir des relations entre les cultures semble plus difficile. Ainsi seulement 17% des jeunes âgés de 15 à 30 ans pensent que l’Europe, « cela ne marchera pas » (l’étude s’est déroulée en octobre 2005, bien après le référendum du 29 mai). Le scepticisme à l’endroit de l’Europe, même s’il augmente légèrement entre 2004 et 2005 (+3 points) est encore très largement minoritaire. Les jeunes Français demeurent, dans leur grande majorité, des Européens convaincus. En revanche, une majorité importante (75%) sont d’accord pour dire que « quoiqu’il arrive, il y aura toujours des problèmes de communication entre les cultures ». Le conflit des cultures est aujourd’hui une réalité et rien ne laisse à penser à la jeune génération qu’on puisse en venir à bout. Ce pessimisme « culturel » vient nuancer sensiblement, là encore, leur optimisme personnel : la globalisation aussi ne va pas dans le sens de leur pensée positive.
On note la même ambivalence dans le domaine de la consommation. D’un côté, la jeunesse française se distingue en Europe par l’attrait qu’exercent sur elle les idées alter mondialistes (de même que leurs aînés du reste) : ils sont 40% contre 30% en moyenne dans le reste de l’Europe à juger les mouvements anti-globalisation utiles (23% des jeunes Allemands ou des jeunes Britanniques). Et ce chiffre ne cesse de croître depuis 2003. C’est « l’exception française ». Une sympathie qui va de pair avec une critique de la consommation : 66% trouvent qu’il y a trop de produits superflus dans les magasins. Les jeunes consommateurs éprouvent de plus en plus le besoin d’ajouter un « sens » à leur consommation, aussi minime fût-il. Ainsi 47% ont-ils déjà acheté un produit du commerce équitable. En même temps, autre paradoxe, l’attrait pour la consommation ne se dément pas. 56% aiment faire du shopping, surtout les plus jeunes et les femmes. L’attrait pour la nouveauté et l’achat imprévu continue à réunir une majorité des suffrages. Et, signe des temps, 45% veulent consommer moins cher non pas pour affronter les temps difficiles et la précarité, ou pour prendre ses distances avec le système consumériste, mais pour acheter plus, c'est-à-dire, pour consommer plus. En fait, si la sensibilité alter mondialiste s’installe année après année, le cœur des militants convaincus, reste stable (autour de 10%). Ce sont les sympathisants du second cercle qui augmentent -les modérés. La consommation équitable séduit, et c’est peut-être là que le lien avec la société pourrait se faire dans les années qui viennent : dans ces petites actions liées à la consommation qui changent (légèrement) les choses et permettent de garder le moral au beau fixe… Il est trop tôt pour le dire. Comme nous le disent les trends setters que nous interrogeons chaque année dans notre étude sur les tendances émergentes, Trend Observer, peut être sommes-nous en train de passer à une autre forme de démocratie et que le salut ne viendra que des micro actions individuelles.
Fiche technique :
Etude réalisée on-line en octobre 2005 auprès de 2 029 personnes âgées de 15 à 30 ans, représentatifs de cette cible en France.
Les résultats complets de l’étude sont disponibles en souscription.
L’étude a également été réalisée selon la même méthodologie en Allemagne, Espagne et en Grande Bretagne.