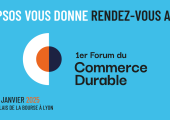Sécurité routière : la crainte de l'accident efface la peur du gendarme
Selon la vaste enquête Ipsos/La Sécurité Routière, les Français désignent l'alcool et la vitesse comme les principales causes des accidents de la route. Par ailleurs, l'opinion n'est pas hostile au renforcement de la présence des forces de l'ordre en ville au bord des routes.
La majorité des Français a le sentiment que la sécurité sur les routes s'est plutôt amélioré au cours des dernières années (48%). Ce constat optimiste est partagé par l'ensemble des catégories sociodémographiques, mais plus encore par les hommes (52%), les 25-34 ans (55%), les artisans, commerçants et chefs d'entreprises (53%), les cadres (53%) et les professions intermédiaires (53%). Par ailleurs, les personnes qui parcourent le plus de kilomètres sont les convaincus de cette amélioration.
Les causes des accidents sont, pour les Français, relatives aux comportements des automobilistes, plutôt qu'à l'état des réseaux routiers. Ils incriminent en particulier l'alcool (82%), la vitesse excessive (62%) et le non-respect des priorités, des stops ou des distances entre les véhicules (40%). L'usage du téléphone portable au volant (26%), la présence de "gens qui ne savent pas conduire" (21%) ou encore la fatigue (20%) sont également cités. En revanche, le manque d'entretien des véhicules (6%), l'état du réseau routier (6%) et surtout l'absence de contrôles efficaces de la circulation (4%) son rarement évoqués
Si la hiérarchie des causes est commune à l'ensemble des personnes interrogées, on constate toutefois quelques différences de perception. Les habitants de l'Ouest (88%) ou de Normandie (86%), les 15-19 ans (90%) et les 20-24 ans (88%) mettent ainsi très directement en cause l'alcool.Les moins de 35 ans sont plus nombreux que l'ensemble à considérer comme cause d'accident "les gens qui ne savent pas conduire" (26%, contre 21% pour l'ensemble). Les plus de 60 ans (78%) insistent sur la vitesse excessive. Le téléphone portable est mis en cause par presque un quart des utilisateurs (22%).De mauvaises conditions climatiques (73%) sont, de loin, le facteur qui incite le plus les gens à la prudence, loin devant la densité de la circulation (39%), le fait de voyager avec ses enfants (36%) ou la fatigue (31%).
D'une manière générale, les conducteurs s'auto-évaluent avec bienveillance. Près des trois quarts des automobilistes estiment être de bons conducteurs (74%, 20% estimant être des conducteurs moyens).
Cette auto-perception semble en partie dépendre du statut social : les cadres (84%), les personnes disposant d'un niveau d'études supérieur (79%) ou encore de revenus supérieurs à 300.000 francs (83%) sont les plus enclins à s'évaluer de manière positive. Parallèlement, plus le nombre de kilomètres parcourus par an est important, plus l'image de se conduite est positive.
Les Français sont en revanche bien plus sévères quand il s'agit de juger les autres automobilistes. Une nette majorité, conducteurs ou non, estime que les conducteurs sont, en France, "moyens" (57%). Les plus critiques sont les moins de 35 ans (66%) et les personnes qui estiment que la sécurité sur les routes s'est plutôt dégradée depuis quelques années (66%).
La confiance en soi-même semble toutefois l'emporter sur l'appréhension du comportement d'autrui lorsqu'il s'agit de qualifier son propre état d'esprit au volant. Plus des trois quarts des conducteurs déclarent être en confiance lorsqu'ils prennent le volant (78%), 15% faisant état d'une inquiétude ou d'une légère appréhension. C'est notamment le cas des personnes parcourant moins 10.000 km/an. On constate également que seul un quart des conducteurs s'estimant "moyens" se déclare inquiet au moment de prendre le volant.
La confiance est en revanche moins partagée lorsqu'il s'agit de prendre "la place du mort". Un tiers des Français (33%) éprouve une inquiétude ou une légère appréhension en tant que passager.
Aux yeux des Français, les publics les automobilistes sont moins exposés aux risques que les motards, les personnes qui font beaucoup de kilomètres sont moins en danger que celles qui en font peu. En revanche, les avis sont nettement plus partagés concernant les conducteurs de petites voitures par rapport aux conducteurs de voitures puissantes, aux personnes conduisant principalement en zone rurale par rapport aux citadins, aux moins de 25 ans par rapport aux plus de 70. Les Français estiment aussi que les personnes qui effectuent tous les jours des parcours différents (61%) sont moins exposés aux risques que celles qui font chaque jour le même trajet.
La très grande majorité des comportements dangereux est jugé avec sévérité par les Français. Le fait de ne pas porter de casque sur un deux-roues (95%), de brûler un feu rouge (93%), un stop (88%) ou de téléphoner sur son portable en conduisant (77%) apparaissent comme les plus graves, devant la vitesse, pourtant fréquemment citée pour expliquer les accidents. En revanche, le fait de conduire lorsque l'on a pris des médicaments (56%), de ne pas boucler sa ceinture à l'arrière (49%), de changer systématiquement de file lorsque la circulation est dense (44%) ou de ne pas boucler sa ceinture pour une courte distance (37%) ne constituent pas, pour une part importante des Français, des comportements systématiquement répréhensibles.
Si l'alcool et les fautes de conduite sont considérées avec une grande sévérité, la vitesse et l'usage de la ceinture de sécurité ne bénéficient pas du même statut. Ces différences de perception se retrouvent au niveau des pratiques. : 40% des personnes interrogées déclarent qu'il leur arrive souvent de ne pas boucler leur ceinture lorsqu'elles sont passagères à l'arrière, 39% de rouler à 120 km/h sur une route où la vitesse est théoriquement limitée à 90 km/h et 32% de conduire en ayant pris des médicaments. On constate une fois de plus que la conduite à grande vitesse souvent pratiquée. En revanche, le fait de franchir une ligne blanche pour doubler un autre véhicule (7%), de brûler un stop (4%) ou un feu rouge (4%) sont des pratiques qui, si l'on en croit les personnes interrogées, sont très rares.
Malgré le nombre de tués chaque année sur les routes, les Français considèrent que l'arsenal répressif est suffisant. Seul l'usage du téléphone portable en conduisant est perçu comme un domaine où la réglementation est insuffisante par la majorité (54%, contre 44% qui la jugent au contraire suffisante). Les autres domaines - l'alcool au volant, la vitesse, le port du casque, l'entretien du véhicule ou le port de la ceinture - sont perçus comme suffisamment réglementés.
Les Français considèrent donc que la loi est suffisante, mais peut-être pas assez appliquée. Ils estiment majoritairement que les forces de police ou de gendarmerie ne sont pas assez présentes sur les petites routes (55%) et en ville (52%), alors qu'elles sont présentes "comme il faut" sur les autoroutes (48%), les routes nationales ou les routes à grande circulation (44%). La prise de conscience du danger semble avoir eu raison de la "peur du gendarme" : le renforcement de la présence des forces de l'ordre au bord des routes est aujourd'hui loin d'être rejeté par l'opinion.