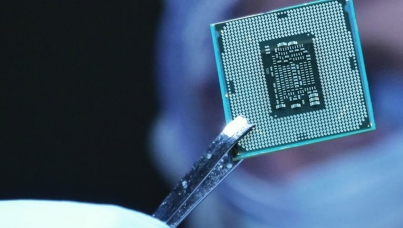Violences sexuelles : pourquoi les stéréotypes persistent ?
Lorsque vos proches estiment que « forcer sa conjointe ou sa partenaire à avoir un rapport sexuel alors qu’elle refuse et ne se laisse pas faire n’est pas un viol », « qu’il n’y a pas viol lorsque l’on vous force à faire une fellation alors que vous ne vous laissez pas faire » ou encore « qu’à l’origine d’un viol, il y a souvent un malentendu », comment ne pas ressentir lorsque l’on a été violée un sentiment de culpabilité et ajouter de nouvelles souffrances à sa souffrance.
Or ce que montre cette enquête, c’est que de très nombreux Français, de tout sexe et de tous âges ont aujourd’hui tendance à considérer qu’il existe de véritables motifs permettant de déresponsabiliser ou d’excuser les violeurs et a contrario d’incriminer la victime, voire de la rendre en partie responsable de ce qui lui est arrivé. Pour se développer, ces idées disposent d’un terreau extrêmement fertile. D’abord les stéréotypes concernant les sexualités féminine et masculine qui sont partagés par beaucoup - par exemple « en matière de sexualité, les femmes savent moins ce qu’elles veulent que les hommes » -. Ensuite, la très forte méconnaissance qu’ont aujourd’hui les Français des « chiffres » du viol et notamment tout ce qui concerne le nombre de viols et de plaintes, les origines des violeurs ou encore l’âge auquel surviennent le plus souvent les viols et agressions sexuelles.
Or, ces stéréotypes amènent une proportion importante de la population à avouer des opinions inquiétantes, notamment à considérer aussi qu’une personne peut éviter d’être violée pour peu qu’elle respecte certaines règles de sécurité et qu’elle se défende le plus qu’elle peut.
Fiche technique: L’enquête a été réalisée par Internet du 25 novembre au 2 décembre 2015 auprès de 1001 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables de sexe, d’âge, de profession de la personne interrogée, de région et de catégorie d’agglomération.